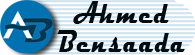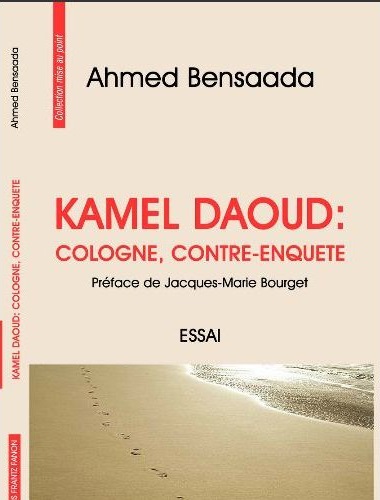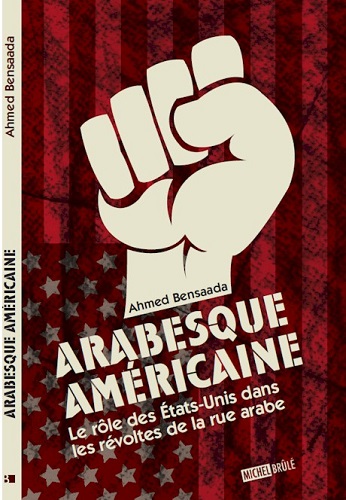À propos de la présence de M. Slimane Benaïssa dans le panel du dialogue national
Le panel, le mtourni et l’espoir dévoyé
Par Abdellali MERDACI*
Le 24 août 2019
Le 1er-Novembre 1954 marque l’acte de naissance de l’Algérie moderne parachevé par le vote d’autodétermination des Algériens du 1er juillet 1962, qui ont choisi massivement leur indépendance nationale. Mais l’avènement de la nation algérienne, solennellement annoncé le 3 juillet 1962, a été suffisamment coûteux en vies humaines pour que le pacte du sang de centaines de milliers d’Algériens qui se sont engagés dans la guerre anticoloniale, morts pour la libération de leur pays, soit oublié, dénaturé et piétiné.
Sujets français ou pour certains d’entre eux naturalisés français, les Indigènes d’Algérie (rappelons que le qualificatif « Algérien » était réservé aux seuls européens) accédaient progressivement à la faveur des Ordonnances de 1944 et de 1947 à la citoyenneté française, sans la disparition des deux collèges électoraux (européen et indigène), fondement de la politique coloniale. Ces mesures législatives, ils ne pouvaient s’en satisfaire. Avant l’insurrection armée du 1er-novembre 1954, à l’appel du FLN, les partis politiques indigènes ou franco-indigène (ainsi, le PCA) ont recherché plusieurs formules pour éradiquer le système colonial, et parmi ces formules l’État fédéral algéro-français, un moment pressenti et défendu par Ferhat Abbas que n’aurait pas dédaigné Messali Hadj, chef du PPA-MTLD. Toutes les hypothèses de sortie de l’emprise coloniale des Indigènes d’Algérie sont tombées devant l’incernable défense institutionnelle et politico-militaire de l’État colonial français. La seule perspective, qui s’imposait, certainement ruineuse pour les combattants algériens démunis face à une puissance militaire mondiale, était la guerre ; elle appelait une rupture juridique et identitaire.
L’indépendance de l’Algérie mettait un terme à l’Algérie française, à ses rites et à ses hiérarchies statutaires. Au printemps 1962, les Accords d’Évian (paraphés par le GPRA et le gouvernement du général de Gaulle) prévoyaient une période intérimaire pour permettre aux Algériens et aux Français – sans exception d’appartenance communautaire et confessionnelle – de faire librement, en Algérie et en France, le choix de leur nationalité. Cette ultime page de l’Algérie coloniale a été tournée sans heurts ni passions. Des Indigènes d’Algérie se sont résolument tournés vers la France ; des Français d’Algérie, catholiques, israélites et agnostiques, se sont reconnu Algériens.
Bi-nationalité et double jeu
Depuis la révolution ratée d’Octobre 1988 et, plus encore, depuis la montée de l’islamisme armé et ses guerres sanglantes, des Algériens, nés et grandis en Algérie, dont les parents ont choisi nettement l’Algérie et la nationalité algérienne, le plus souvent formés et promus par l’Algérie, ont profité du chaos des années 1990 pour faire leur retour dans la nationalité française. Quittant leur pays en flammes, ils ont été moins dans un repli provisoire que dans une fuite éperdue. Ils l’ont fait en toute responsabilité sous le prétexte qu’ils étaient menacés par l’islamisme. Mais, à cette époque, ce sont toutes les forces vives du pays qui l’étaient et un responsable du FIS, ancien troupier de la Wehrmacht et des « « SS Mohamed » dans la France occupée des années 1940, projetait, lors d’un meeting du FIS dans un grand stade d’Alger, la mise à mort de trois millions d’Algériens. Funeste comptabilité d’un islamisme encore toléré ? Les élites du pays, toutes spécialités confondues, étaient promises à la « solution finale ».
Mais le malheur de l’Algérie était pour beaucoup une aubaine pour retourner sans état d’âme à la nationalité française. C’est le cas typique (et quelque peu pittoresque !) des frères Lamdaoui de Constantine, dont l’un deviendra l’indispensable et dispendieux valet de pied de M. François Hollande, premier secrétaire du Parti socialiste français, puis président de la République française (2012-2017).
Les Algériens qui ont quitté leur pays, au cœur de la guerre fratricide de la « décennie rouge », qui en compromettait l’unité et l’avenir, non pas pour un courageux et édifiant exil, mais pour se placer sous la protection et le confort de la nationalité de l’ancien colonisateur, n’ont pas droit au respect. Ils ont quasiment déserté devant le feu, qui a emporté nos frères et sœurs par dizaines de milliers, et abdiqué leur dignité nationale. Ce fait peut-il être frappé de sourde indifférence ?
Or, s’il est sans grande conséquence que des Algériens, à l’étroit dans le plus grand pays d’Afrique, deviennent Américains, Canadiens, Anglais, Australiens ou nationaux de pays de tous les continents qui n’ont pas avec l’Algérie le lourd contentieux historique de la colonisation, le retour à la nationalité française est un déni du sacrifice des martyrs de la guerre d’indépendance et de tous les génocides de la conquête militaire française, au XIXe siècle, et du maintien de l’ordre colonial, notamment à Sétif, Guelma et Kherrata, au XXe siècle. Chaque Algérien, redevenu Français, prolonge l’Algérie française, en apostasiant le lien national sacré.
Cependant, les Algériens d’hier, d’aujourd’hui et de demain sont libres de changer de pays et de nationalité, de se faire précisément Français, à la seule condition d’avoir le courage de ce choix et de l’assumer sans faillir, d’exister exemplairement pour leur pays d’adoption, sans convoiter d’incroyables prébendes dans le pays autrefois abandonné. À l’image de l’écrivain Anouar Benmalek, indécrottable invité du Salon international du Livre d’Alger, qui déclarait entrer au pays avec le passeport français, en s’en vantant avec une malsaine jubilation, ils sont nombreux à retourner en Algérie pour prendre des responsabilités et des honneurs qui devraient distinguer les seuls Algéro-algériens qui ont vécu et continuent à vivre, souvent dans la meurtrissure, leur pays au quotidien.
Quel est donc ce pays du million et demi de martyrs qui les trahit en attribuant la Médaille du Mérite national à un néo-Français originaire d’Algérie, vestale du sionisme international ? Plus que par l’Histoire, ceux qui ont accordé cette Médaille, irriguée du sang des Chouhada, au réalisateur français d’origine algérienne Merzak Allouache, de retour du Festival du cinéma de Haïfa (Israël) où il soutenait cyniquement avoir représenté son pays, la France, doivent être jugés par les Hommes. Ni l’Algérie, ni sa politique, ni sa Culture n’ont besoin de cette confusion, de ce double jeu et des ambiguïtés de la bi-nationalité.
Une espérance de paix pour les Algériens et par les Algériens
J’ai dénoncé publiquement, en 2018, dans les colonnes de la presse en ligne d’Algérie la nomination par M. Azzeddine Mihoubi, alors ministre de la Culture, de M. Slimane Benaïssa, bruyamment naturalisé Français au début des années 1990, dans les fonctions de commissaire du Festival international du théâtre de Bejaia. Il serait vain de considérer le dramaturge au moment de son passage en France comme un aventureux et misérable harrag. Je recommande instamment à ceux qui veulent savoir dans quelles conditions il a été pris en charge et exfiltré par les services de l’ambassade de France à Alger pour rejoindre Paris et retourner à la nationalité française de lire les pages que lui consacre Sévérine Labat dans son ouvrage La France réinventée. Les nouveaux bi-nationaux franco-algériens (Paris, Publisud, 2010).
J’ai découvert fortuitement, dans l’édition du Soir d’Algérie du 10 août 2019, que le dénommé Slimane Benaïssa a été intégré dans le panel du dialogue national dirigé par M. Karim Younès. Cette désignation d’un mtourni honteux dans une institution nationale qui a pour objectif de favoriser un consensus entre Algériens dans cette phase difficile de leur histoire est autant imméritée que choquante.
Cette nouvelle turpitude, à l’heure foisonnante du « hirak », rejoint les errements des gouvernements de M. Bouteflika qui ont ouvert la porte aux binationaux de tous acabits. M. Benaïssa est-il irréprochable ? Algérien, il a demandé et obtenu la nationalité de la France envers laquelle il a des droits et des devoirs. C’est un acte d’infidélité envers son pays d’origine, envers son histoire singulière : l’Algérie est et restera le Pays des Martyrs ; on ne lui fait pas l’affront d’une seconde mère. Le dramaturge a estimé devoir refaire sa vie en France et il s’y est prêté plutôt mal que bien : comédien et metteur en scène sans enracinement dans la profession et, hasardement, auteur de romans de piètre qualité, sans aucune audience.
Sur le tard, comme bon nombre de ses congénères qui ont tout raté en France, Slimane Benaïssa est retourné dans son pays d’origine pour faire du rattrapage, guignant en prédateur avisé provendes et prébendes. Ainsi, le commissariat du Festival du théâtre de Bejaia. Et, désormais, une mission inouïe au panel du dialogue national.
Comment, lorsqu’on a trahi et répudié son pays, peut-on faciliter et arbitrer le dialogue entre Algériens ? Quels sont ces nationalistes avérés qui vont accepter la médiation d’un néo-Français ? Plus que jamais, le changement est nécessaire et urgent dans notre pays et dans notre société. Mais est-il à ce prix ? M. Younès, qui ne doit pas douter que le dialogue, s’il a lieu, mettrait sur la table d’improbables vérités, prend-il la mesure de sa décision d’accueillir dans son panel le Français d’origine algérienne Slimane Benaïssa ? La loi algérienne est claire : les hautes responsabilités politiques et stratégiques de l’État ne peuvent être confiées à des binationaux.
Faudrait-il y insister ? L’espérance de paix en Algérie ne doit être discutée et partagée qu’entre Algériens, de quelque tendance sociopolitique qu’ils soient, et il est souhaitable qu’ils retrouvent plus que l’unanimité le sens de l’unité de notre cher pays pour lui donner un destin neuf. Ceux qui ont trahi l’Algérie et la nation algérienne au moment où elles étaient à terre, dans la souffrance, les deuils et la mortification, les mtournis de toutes obédiences au front grêlé de sombres infamies, ne devraient pas y émerger en donneurs de leçons fantasques et infatués.
Depuis l’irruption du « hirak », ces coopérants, d’une triste complexion, ces « pied-gris », autoproclamés experts salvateurs, squattent les colonnes de la presse algérienne, déblatèrent à l’envi sur tout et rien, même sur les qualités physico-chimiques du drapeau national dont ils se sont volontairement détournés pour saluer d’autres couleurs, d’autres croyances, et jurer fidélité à d’exclusives allégeances. Cette nation blessée, qu’ils ont quittée sans regret, vers laquelle ils reviennent la conscience embrumée, garde les traces de leurs mordantes forfaitures. Ils n’y ont aucune légitimité.
*Professeur des Universités, écrivain.

D’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre. Où se situe l’exil?
Par Slimane Benaïssa (*)
Le Soir d'Algérie, le 20 mars 2018

Qui est l’autre ?
Celui qui a une couleur de peau différente de la mienne ? Celui qui est d’une religion différente, de sexe différent, de nationalité différente, de culture différente ?
Qu’est-ce que l’autre ? L’autre, avant d’être une différence, est avant tout et en grande partie une ressemblance. Car on ne peut comparer, en positif ou en négatif, que des choses qui se ressemblent.
Pour accepter ou rejeter un individu, il faut qu’il soit totalement comme nous, à une différence près. Le paradoxe est que cette différence devient le tout et le tout qui nous ressemble devient une quantité négligeable. Et certains oseront affirmer que cette infime différence détermine le tout !
Si on s’arrête à cette définition de l’autre, on ouvrira la porte à toutes sortes de discriminations qui répondent à la simple équation : il est différent, donc il mauvais ; il est différent de moi qui suis le bien, donc il est le mal.
«Autre» avant d’être un pronom indéfini, un adjectif, est philosophiquement défini comme «catégorie de l’être et de la pensée qualifiant l’hétérogène, le divers, le multiple».
Et là, je citerai une manière chez les Arabes d’introduire l’enseignement de la philosophie ; ils instruisent le débutant sur la notion de philosophie par l’anecdote suivante : deux frères jumeaux qui, pour se différencier, portent chacun un tarbouche différent. Un matin, l’un des deux se réveille et met le tarbouche de son frère. En se regardant dans le miroir, il se dit : «Si maintenant je suis mon frère, alors qui suis-je ?» Cette question est le début de la philosophie.
On voit bien qu’on ne peut s’interroger sur l’autre sans s’interroger sur soi-même, ce qui nous mène tout droit à la troisième définition de l’autre, la définition psychanalytique. Selon Lacan : «L’autre est le lieu où se situe un au-delà du partenaire imaginaire, ce qui est intérieur et extérieur au sujet et le détermine néanmoins.» On passe à travers les différentes définitions de l’autre, de l’adjectif qui mène au rejet en passant par la définition philosophique qui mène à l’interrogation sur nous-même et la définition psychanalytique qui définit l’autre comme quelque chose qui me détermine. Donc l’autre est en moi.
La meilleure façon de considérer l’autre, c’est d’être l’autre, de vivre avec l’idée que l’autre c’est tout simplement moi. L’autre est en nous ! Si l’autre est en nous et que nous sommes les autres, alors on est enclin à se poser la question que se pose le deuxième frère : qui sommes-nous ?
Ce NOUS qui peut être collectif ou individuel est déterminé par notre propre histoire. Nous évoluons ou nous régressons, selon les cas, en fonction de notre histoire.
Comme chaque individu, société, communauté a une histoire différente et dans beaucoup de cas opposée à celle de l’autre, sinon antagoniste, comment ces sociétés vont-elles construire leur paix ? En tout état de cause, ce n’est ni en additionnant toutes les histoires ni en exhibant les douleurs engendrées, ou les gloires obtenues. L’histoire, malheureusement, est une suite d’événements justes ou injustes sur lesquels nous ne pouvons plus agir, mais, au contraire, nous devons les considérer telles qu’elles sont, quelle que soit la douleur, quelles que soient les injustices. Nous n’avons sur l’histoire qu’un seul pouvoir, celui de la lire et de la relire pour comprendre ce qui s’est réellement passé et cette compréhension constitue la mémoire. La mémoire est en quelque sorte constituée de notre compréhension de notre histoire et de l’analyse qu’on fera des événements à travers le prisme de nos valeurs.
Les mémoires, contrairement à l’histoire qui nous enferme, peuvent fusionner entre elles et construire de nouvelles mémoires qui intègrent celles des autres. C’est pour cela qu’il est important que la mémoire soit l’émanation de la vraie histoire ; si on déforme l’histoire, la mémoire sera mal nourrie et inopérante pour l’évolution des sociétés. Si nos histoires respectives nous séparent, nous éloignent, les mémoires peuvent nous rapprocher, nous unir.
J’ai été élevé et j’ai grandi dans quatre langues : l’arabe dialectal, le tamazight, le français et l’arabe classique. La question de l’autre était en principe résolue en moi, puisque mon MOI était fait d’autres, puisque l’altérité ne peut être concevable que dans un cadre pluriel. Mais pour beaucoup d’Algériens, l'autre non conflictuel ne peut être qu'étranger… Et je commencerai par une citation de la sociolinguiste Amina Aït-Sahlia qui écrit dans un article en 1999 : «L’autre en discours» : «Reconnaître la part d'autre dans un même, c'est aussi reconnaître en soi sa part d'autre. Plus que la crainte de reconnaître l'autre en tant que tel, c'est aussi peut-être la crainte d'être déstabilisés que redoutent les Algériens en reconnaissant l'autre en eux-mêmes. N'est-ce pas la crainte de se retrouver étrangers à eux-mêmes ? Et pourtant... Moi-même et tous les Algériens sommes tous le résultat de siècles de brassages culturels. Nous sommes tous inévitablement porteurs de notre part d'autre.»
Les communautés ou les sociétés comme l’Algérie revendiquent l’altérité vis-à-vis de l’extérieur et la refusent à l’intérieur. Cette double relation à l’altérité est contradictoire et dangereuse en cas de conflit. Étant tous les mêmes en tant qu’éléments d’une même communauté, nous avons les mêmes différences et nous devons avoir les mêmes agissements vis-à-vis de l’autre extérieur. C’est ainsi que n’importe quel Arabe peut venger n’importe quel autre Arabe. La négation de l’altérité à l’intérieur par la négation de la pluralité multiplie à l’infini les conflits avec la pluralité extérieure.
Voici dans quel esprit j’ai reçu l’héritage de ma pluralité et le pétrin dans lequel a fermenté la pâte de mon métissage. J’ai compris que je devais défendre la pluralité, qui me définit sur tous les fronts.
Expérience algérienne
Au théâtre, j’ai choisi de m’exprimer en arabe dialectal qui est la langue maternelle de la majorité des Algériens et représentative de son histoire. Elle a drainé toutes les influences qu’a connues le peuple algérien : berbère, romaine, turque, arabe, française. Elle est à ce titre une référence sûre. C’est dans cette langue que le public algérien s’entend, qu’il se comprend, qu’il veut débattre et évoluer.
Cette langue étant une langue d’oralité, elle a une structure dont le centre est la mémoire et la mémorisation. Elle est organisée de manière à ce que tous les récits développés soient mémorisés à l’écoute. La culture orale développe à cette fin d’innombrables techniques :
Elle possède, entre autres, deux grandes qualités qui me permettent de dépasser tous ces conflits linguistiques et me servir de point d’appui pour créer une langue pour le théâtre :
Sa première qualité est d’avoir su dépasser les limites du discours social à travers un langage par sous-entendus que les poètes et les narrateurs, qui ne pouvaient pas tout dire en public, ont développé.
Sa deuxième qualité est d’avoir su déjouer la censure coloniale à travers des codes de communication développés par les orateurs.
Face à cette double répression, morale et politique, la langue n’était plus dans ses mots, elle n’était plus dans ce qu’on entendait, mais dans ce qu’elle sous-entendait.
Par ailleurs, à l’école française, j’ai appris que le théâtre ne se réalisait pas totalement dans ce qui est dit, mais dans le non-dit. J’ai tenté alors d’élever les sous-entendus de la langue maternelle à la force des non-dits pour construire une langue pour le théâtre algérien. A un moment de cette expérience, j’ai compris que cela ne suffisait pas, parce que le sous-entendu était une construction qui se développait sur les images. A partir d’une image, on suggère une autre. Ce procédé déguise la langue mais n’apporte pas du sens, il favorise la redondance, alors que le non-dit surfe justement sur le sens. On développe un sens audible, qui ouvre la porte sur plusieurs sens non-dits, et ces non-dits prennent tout leur sens dans l’imaginaire du public.
Toutes ces techniques, une fois libérées de la problématique de la mémoire, deviennent des outils dont on se sert pour faciliter l’écoute au théâtre et nous offrent différents registres au service de l’écriture dramaturgique. L’arabe dialectal a subi l’influence de l’arabe classique qui est intimement lié au Coran. Il fallait le laïciser, le libérer de son contenu systématiquement religieux et en faire une langue qui parle simplement de l’humain. On ne peut atteindre notre public qu’en arabe algérien, mais cette langue a l’expérience et les limites culturelles de ceux qui la parlent. La seule issue pour nous, dramaturges, était de faire évoluer la langue elle-même. Mais compte tenu de l’évolution sociale rapide, la langue dialectale, bousculée par la réalité industrielle et technologique, se trouve acculée à un enrichissement anachronique et s’exténue. Il fallait lui éviter cela… Mais on ne fait pas penser une langue, c’est la langue qui nous fait penser. Conscients de cela, on comprendra aisément que toute pensée nouvelle s’affronte en premier lieu à l’outil linguistique. Une idée nouvelle qui s’affronte à un code traditionnel ne peut s’imposer qu’en créant un code à sa mesure, partant du premier et se référant à lui. Nous poussions la langue dans ses limites naturelles tout en essayant de tracer des limites à nos idées acquises ailleurs et qui, elles, étaient sans limite. L’arabe dialectal devait évoluer afin de devenir une langue nationale. A notre niveau, tout en inventant un théâtre, nous avons forgé cette langue en brassant les régionalismes linguistiques, nous avons participé à la création de notre langue nationale.
Nous avons perdu beaucoup de temps et d’énergie à redonner à chaque langue sa juste valeur, sa juste place, dans un contexte politique hostile qui manquait de vision et de sérénité à l’égard de toute forme de pluralité. Il est important de signaler qu’au vu de la situation conflictuelle dans laquelle se trouvaient les différentes langues, le fait de choisir telle ou telle langue pour s’exprimer publiquement constitue une posture politique en soi, car dans ces conditions de guerre des langues, le choix d’une langue par rapport à une autre a une signification politique. C’est pour toutes ces raisons que la langue n'est pas pour moi un simple outil que je façonne, que je perfectionne, elle est le fantôme qui hante mon histoire et par laquelle il me faut rêver. Je ne porte pas ma langue maternelle, je suis porté par elle. Je porte la langue française et je suis emporté par elle. Telle est l’équation de mon bonheur de métis, au-delà des malheurs de mon histoire et des miens.
C’est à travers cette histoire, qu’elle soit belle, sereine ou conflictuelle, que nous avons dit notre peuple avec les colères qui sont les siennes, avec la pudeur qui est la nôtre, et parfois avec les maladresses des poètes errants que nous sommes, dans un monde où il est souvent ridicule d’expliquer et douloureux de se taire.
L’Histoire des «Nôtres» a forgé notre esprit et notre imaginaire jusque dans l’intimité des métaphores. Le malheur a fait le poème, notre espoir est que la paix en fasse un chant.
Par ailleurs, étant le fils d'un pays qui ne cesse depuis des siècles de chercher sa paix, le début de ma paix est dans la paix des langues qui m’habitent et que j'apaise sans cesse pour les apprivoiser afin qu'elles puissent porter nos malheurs avec sérénité et oser la joie. L'apaisement de ces langues est un poème en soi, il est notre vrai talent.
Je dirais même notre unique talent, celui qui nous est prescrit par ordonnance testamentaire.
Les langues qui me traversent sont porteuses de toute mon énergie à dire et à écrire, quand elles sont en conflit à l’intérieur de moi, ma colère devient inaudible parce qu’aucune des langues n’ose la dire et je perds la voix. Quant à mon peuple, il mélange d’instinct l’arabe au français, le tout assaisonné de berbère, il cherche désespérément leur alliance pour dire sous une forme nouvelle ce qu’il ressent depuis toujours, parce que le peuple, malgré la misère, a horreur de se répéter face au malheur. Il crée pour se garder en estime.
Les langues écrites nous sont utiles certes, mais nos langues maternelles qui ne sont qu’orales nous sont vitales malgré tout, parce qu’elles nous déterminent. Elles sont l'espace de cette mémoire qu'on oublie et qui continue de nous transformer malgré nous. Les langues populaires naissent dans le peuple et s’épanouissent dans l’élite.
Les peuples, rarement heureux, ont très peu de mots pour dire le bonheur, trop de mots pour cacher la honte du malheur. Quand celui-ci n'est plus à cacher, il se tait. Et la langue s'atrophie, elle se noie dans les larmes, elle se fait clandestine dans les terreurs. Elle se fait petite parce qu'elle reconnaît son impuissance à dire autant de malheurs. Et nous sommes contraints de dire ce malheur comme gage de notre liberté.
De quelle liberté suis-je capable si je dois piétiner l’analphabétisme de ma mère et de mon père ? Eux qui souffraient déjà de leur ignorance parce qu’ils mesuraient ce qu’ils ne savaient pas. Je voudrais vous faire un aveu : à mon âge, et malgré tout ce que j’ai écrit, je n’ai écrit que l’analphabétisme de mes parents et je ne sais pas quand je commencerais à exprimer ma propre conscience du monde, quand vais-je pouvoir m’écrire.
Comment, dans ce chaos linguistique, arriver à créer un théâtre pour un public algérien et dans sa langue maternelle ?
Au bout de toutes ces tentatives, je ne sais comment, j’ai décidé, afin d’arrêter de tourner en rond, de faire en sorte que la langue soit le personnage principal de toutes mes pièces.
C’est-à-dire mettre en situation hors réalité des personnages pour qui il fallait inventer une langue, sinon ils ne sauraient pas dire ce qu’ils vivent et seraient incapables de dialoguer. Il fallait supprimer tous les référents culturels de la langue et l’obliger à assumer une situation inédite.
De cette façon, j’ai eu une plus grande aisance à travailler mes textes parce que j’ai libéré la langue de sa quotidienneté et l’ai inscrite dans un autre réel, là où elle ne s’est jamais risquée. Par cette démarche, c’est moi qui décide à quelle référence je rattache la langue, les références de la langue ne s’imposent plus à moi.
En fin de compte, quand l’idée d’une pièce me vient, je sais quelles idées je dois écrire dans ma langue maternelle et celles que je dois écrire en français. C’est le projet d’écriture lui-même qui me guide pour prendre la décision d’écrire soit en arabe soit en français. Ce qui détermine mon choix est très instinctif, mais il y a d’autres paramètres qui entrent en jeu pour justifier rationnellement ce choix.
J’ai longtemps cru que les deux démarches étaient totalement distinctes et séparées. J’essayais alors de me placer dans le cadre culturel de chaque langue pour trouver ma démarche théâtrale et dramaturgique. Pour moi, celle-ci était intraduisible d’une langue à l’autre et si je devais les traduire il n’y avait qu’une seule issue : réécrire. Je considérais que si moi j’étais bilingue, mes écrits n’étaient pas bijectifs et vice-versa.
Douze ans après avoir écrit Les fils de l’amertume, pièce sur l’intégrisme islamiste et la décennie noire en Algérie qui a été jouée en 1995 dans le «In» du Festival d’Avignon, j’étais convaincu qu’elle était intraduisible dans ma langue maternelle pour plusieurs raisons, dont deux principales. Je pensais d’abord que si je la traduisais, il fallait que je tienne compte des formules religieuses minimum, du code linguistique inhérent au discours religieux et sur la religion. Ce qui ferait dire à la pièce le contraire de ce que je voulais dire.
Ensuite, je pensais que pour décrire la société dans laquelle est né cet intégrisme, il fallait plonger dans ses profondeurs et fatalement bousculer ces codes moraux, éclater les limites du discours social jusqu’à la trahison, jusqu’à la dénonciation.
Pour toutes ces raisons, je pensais que cette pièce resterait à jamais intraduisible, du moins injouable, devant un public algérien, en arabe algérien.
Pendant 12 ans j’étais tourmenté par le fait qu’elle soit intraduisible parce que je ne voulais pas m’inscrire dans un théâtre d’exil. Si elle était inaudible pour le public algérien, j’avais trop honte d’avoir mal traduit ses malheurs au public français. Il me fallait une preuve qui légitime au moins mon rôle de passeur.
Jusqu’au jour où, revenant de Bruxelles, seul en voiture, alors que je ne pensais pas particulièrement à cette traduction, je ne sais pas par quelle démarche hasardeuse l’équivalent d’une réplique de la pièce en arabe algérien me traverse l’esprit. Je sors au prochain arrêt d’autoroute et je traduis de mémoire toute une scène.
C’était tellement juste et beau que j’en ai pleuré. Je suis resté trois heures dans cet arrêt, incapable de reprendre la route, comme si j’étais arrivé quelque part en moi. Je venais de retrouver ma langue maternelle cachée derrière la langue française et tellement intimidée par elle qu’elle m’a fait croire à moi, pendant 12 ans, qu’elle n’était pas là.
J’ai repris la route, unifié dans ma pensée et plus pluriculturel que jamais. Voilà un exemple où les deux cultures et les deux langues que je porte en moi fusionnaient parfaitement dans mon esprit pour dire aux Français ce que vivaient les Algériens. Est-ce la gravité des événements qui font l’objet de la pièce qui m’ont obligé à aller chercher en moi plus que la synthèse des langues et leur indépendance ? Est-ce la force des émotions qui me traversaient qui a chauffé à blanc les deux langues, les deux cultures pour n’en faire qu’une ? Est-ce le désir de porter à un public français la vérité douloureuse d’un vécu algérien qui a fait que les deux cultures se sont mêlées et que les deux langues ont tressé un seul et unique texte pour deux langues ? Je ne le sais pas.
Toujours est-il que, depuis ce jour, je suis convaincu que la littérature cache plus qu’une langue, comme l’art cache plus qu’un regard. La littérature et l’art sont pluriels par essence, il est regrettable d’avoir une seule culture pour lire et un seul regard pour voir.
Expérience française
La génération d’écrivains qui nous ont précédés, celle de Kateb Yacine, Mohammed Dib, Malek Haddad, Mouloud Feraoun, était inscrite au cœur même du combat pour l'indépendance et la langue française était l’outil idéal pour porter le combat en métropole. La problématique de la langue ne se posait même pas pour eux tant la nécessité, l'urgence de la lutte n'avaient pas le temps de discuter des langues à utiliser.
Mais aujourd'hui, après l'indépendance, nos politiques ont rejeté la langue française avec les valeurs qu'elle porte en elle, droit de l’homme, démocratie, etc., sous prétexte qu’elle était la langue du colonisateur. L’identité de la société algérienne allait se construire en dehors des valeurs de la culture française et c'est là où les choses se compliquent. Car l'amalgame a été fait entre valeurs, culture, identité et histoire.
Il est difficile de faire admettre à nos gouvernants, qu'on peut s'approprier la culture française dans ses valeurs et construire notre identité propre tout en réglant nos problèmes d'histoire avec la France.
C'est cette incompréhension qui nous a placé nous comme opposant naturel aux différents pouvoirs et nous a contraint petit à petit à un exil intérieur et qui a fini par devenir un exil vers l’extérieur.
Nous, dramaturges, avons été formés en français, certains en arabe classique, deux langues dont l’expérience n’est pas celle de notre langue maternelle. Comme dit Benjamin Stora : «La migration algérienne en France est marquée d'une double empreinte. Elle est à la fois héritière d'une tradition maghrébine et islamique, mais aussi du très long contact entretenu par les Algériens avec le colonisateur, qui leur a imposé sa langue comme moyen d'expression.»
Notre regard sur la réalité relève de nos connaissances, mais celles-ci furent acquises ailleurs. Nous regardons notre réalité à partir d’un espace extérieur à la langue avec laquelle nous devons communiquer. Un Français éduqué et formé dans sa langue maternelle (le français), quand il parle de la réalité française, il s’exprime parce qu’il y a dans son imaginaire une continuité linguistique et culturelle.
Quant à moi, quand je regarde la société algérienne pour en parler en arabe algérien à des Algériens, souvent je pense en français ou en arabe classique, pour dire en arabe algérien, ce qui fait que je ne m’exprime pas, je traduis. Parce qu’il y a discontinuité linguistique et culturelle due à ma formation. Cette discontinuité fait que je négocie les mots, je ne les invente pas, elle me pousse au compromis et là, soit je compromets la réalité que je veux dire, soit je compromets la langue que j’utilise. Je n’ai pas les angoisses du créateur, j’ai les aphtes du créateur réduit à se traduire.
Ajoutons à cela que les trois cultures, les trois langues, ne sont pas superposées et indépendantes dans mon esprit. Mon métissage n’est pas la somme des langues que je connais, il est une fusion des cultures en moi. Ma pluralité est une synthèse faite des trois cultures. De ce point de vue, mon regard est différent de celui de ma culture d’origine. Il est aussi différent de celui de mes cultures acquises.
Si je maîtrise la langue, cela ne veut pas dire que je connais suffisamment la société française pour pouvoir y exister comme homme de théâtre. Édouard Bond dit : «Le théâtre n'est pas une chose que l'écrivain crée en misant sur sa seule ingéniosité personnelle, c'est une activité sociale.»
En quittant mon pays, je me retrouvais en tant qu’homme de théâtre, doublement menacé d'exil territorial et d'exil professionnel. D’autant plus que c’est dans l'espace de théâtre que je reconstituais l’idée que je pouvais avoir de mon pays.
Pour pouvoir échapper à l’exil professionnel, il m'a fallu plonger dans la société française avec enthousiasme et grand appétit pour la connaître et me laisser imprégner d’elle. Il me fallait aussi l’aimer pour me donner le désir de la raconter à elle-même, c'est-à-dire à un public français. Cette plongée ne pouvait se faire qu'avec un seul guide : notre histoire commune.
Tout exilé doit s’adapter au pays d'accueil. Pour les hommes de théâtre, il ne s'agit pas de s'adapter à la vie du pays mais de se convertir, et cette conversion nécessaire va mettre en danger, non pas nos choix politiques et philosophiques, mais bien plus que ça. Elle met à l'épreuve notre capacité à accepter l’autre.
Écrire et faire du théâtre, c’est choisir les émotions justes sur lesquelles on articule des idées pour les rendre audibles. C’est cette alchimie qui entre en jeu, consciemment ou inconsciemment, dans tout processus de création. L’équilibre entre émotions et idées, entre le ludique et l’intellectuel, doit être maintenu. S’il est profondément perturbé, il devient alors déstabilisant et engendre une perte de confiance en soi et l’autre devient dangereux.
Un voyage initiatique est nécessaire pour se refaire et apprendre à accepter l’autre. Ceux qui osent le voyage deviendront féconds pour le pays d'accueil. Ceux qui n'osent pas ou refusent ce voyage nourrissent des ressentiments contre le pays d'accueil parce qu'ils le rendent responsable de les avoir mis devant des choix impossibles.
Quel a été mon voyage ?
Je me définis comme triculturel, de culture berbère, française et arabe. Ma langue est ma pluralité ; mon lieu culturel est mon métissage. Ma parole en est la synthèse. Ainsi, je suis le fils de l’histoire et non de mes parents. Ils ont été mes géniteurs biologiques et mon existence culturelle allait se faire ailleurs que dans l’espace d’origine.
L’histoire allait devenir une sorte de lieu psychanalytique dans lequel je forge ma pluralité. Aujourd’hui elle est la justification et la raison de mon outil : la langue. Elle est mon alibi identitaire. Celle du métis qui sait plusieurs langues et que chaque langue ignore.
Et c’est là où j’ai pris conscience que la liberté francophone n’est pas une essence, mais une conséquence. Parce qu’une fois qu’on a pris suffisamment le temps de tout détruire autour de vous, jusqu’au moindre balbutiement, quand ma mère a fini par parler le silence dialectal, la langue française devient un véritable espace de liberté et le lien réel et unique avec l’universel. Mais à partir d’où et pour dire quoi ? Et là, les questions se succèdent creusant un gouffre entre ce que je ressens vouloir dire et les outils que j’ai pour le dire.
Naissent alors en moi des blocages, des inhibitions, dues au fait que je prends conscience au fur et à mesure, que je possède une langue, une culture qui m’ont déplacé de mon espace d'origine sans m’inscrire tout à fait dans son espace. Nous sommes des banlieusards de la littérature. Parce que du côté français l'esprit de culture dominante persiste avec force. Voilà ce que dit M. Dominique Wolton dans une conférence faite sur le thème «Diversités culturelles et francophonies». Je cite :
«Je prendrai un exemple politique important : nous venons de vivre en France – et nous continuons de le vivre — un débat très important sur la question de la laïcité et sur le problème de savoir s'il faut ou non faire une loi concernant le voile, vu comme un symbole. On a longtemps perçu la laïcité française comme un modèle d'intégration. Nous l'avons vécue culturellement comme un moyen d'intégration mais avec une connotation de domination.
Autrement dit, depuis 1905, les gens s'intégraient au modèle de la laïcité, modèle républicain français, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ce qui change — et on le voit très bien dans les réactions en France et à l'étranger par rapport à l'hypothèse d'une loi — c'est que les autres sont beaucoup plus visibles qu'avant. Autrement dit, celui pour lequel on veut défendre les valeurs laïques ou que l'on veut intégrer dans un modèle républicain n'est plus d'accord. Parce que nous étions dans un modèle culturel de domination et que nous sommes maintenant dans un modèle culturel de coopération et qu'on ne peut pas imposer à d'autres communautés, en France et à l'étranger, au titre d'un certain ‘‘art démocratique’’ ou d'une certaine conception de la laïcité, un modèle qui ne lui correspond pas.
Et je suis frappé de constater, dans le débat sur la laïcité, que les meilleures intentions du monde se retournent contre ceux qui les invoquent, tout simplement parce que l'autre est présent chez nous, et en fait, traite la République française de néo-communautariste, ce qui est exactement l'inverse de ce que nous voulions faire.
Je vois dans ce symptôme, ce surgissement des hostilités radicales à une législation, le fait que ce qui a changé en un siècle, c’est que l’autre est présent et que l'altérité existe. Ce qu’il se passe pour la laïcité, je pense qu’il pourrait se passer pour la francophonie : une partie des peuples, des communautés francophones, pourrait un jour se retourner contre la France en disant : ‘‘Vous avez un rôle essentiel dans la francophonie, mais vous n'êtes plus propriétaire de la francophonie et vous n'êtes plus propriétaire de sa définition et des compétences culturelles.’’ Pour éviter cette espèce de boomerang que nous sommes en train de recevoir sur la laïcité, il nous faut ouvrir, le plus tôt possible, la francophonie à une bien plus grande diversité culturelle en son sein. De ce point de vue-là, comme travail pratique, il faudrait faire une liste des divergences qui existent au sein de cette francophonie, avec les enjeux culturels, politiques, idéologiques et historiques... Il faut aussi reprendre quelque chose qui me tient énormément à cœur, car je pense qu'on n'avancera pas dans la diversité culturelle au niveau mondial sans cela, ce sont les problématiques de la colonisation et de la décolonisation pour comprendre ce qui fait que les gens, malgré le fait qu'ils soient sensibles à la francophonie, sont d'accord ou pas sur telle ou telle chose.»
Cette domination culturelle qui persiste est aliénante, elle prend en otage notre imaginaire. Nous sommes considérés comme des utilisateurs de la langue et non des créateurs dans la langue. Le seul apport créatif dans la forme attendu de notre part, c’est introduire des arabismes ou des africanismes dans la langue et tout le monde crie au génie !
Et les critiques sur nous sont des jugements paternalistes, et les prix qu’on peut avoir sont des prix politico-littéraires, qui récompensent non pas notre talent d’écrivains mais plus notre talent à nous sentir francophones. Les gouvernements étant politiquement alliés de nos gouvernants, leur complicité fait qu’on n’existe plus là-bas et qu’on a l’illusion d’exister ici.
Nous finissons par être des hybrides qui ne correspondent à rien. Entre-temps, nous avons été évacués de notre réel terrain d’efficacité, c'est-à-dire nos sociétés, et nous avons servi à renforcer les politiques francophones. Si j’ose dire cela c’est parce que j’ai un sérieux problème avec la «solidarité francophone». Où se situe cette solidarité ? On est solidaire de quoi ? Et pour faire quoi ? Et qui est solidaire avec qui ?
Les raisons profondes de ce genre de situations sont très bien analysées par Mme Baida Chikhi dans un article «La francophonie aujourd’hui : réflexion critique».
«En somme, déclinée à tous les modes, à tous les genres, comme la ‘‘fée Clochette’’, la francophonie est soumise au paraître/disparaître et à l'humeur d'un agitateur masqué ; son apparence et son intérêt varient selon le point de vue à faire valoir. Mais reconnaissons que c'est en France que la francophonie semble poser problème.
La même question revient, à peine voilée, comme une litanie : que faire de tout ça ? De tous ces textes écrits en français ? De ces écrivains qui viennent d'ailleurs et se font publier ici, raflent les prix littéraires, envahissent les librairies et les salons littéraires ? Comment les nommer ? Où les placer ? Comment les classer ?»
Par ailleurs, l’occultation de l’histoire est aussi chose aliénante et jusqu’où peut-on occulter l’histoire. Si la langue française porte la culture française, elle porte aussi notre histoire commune et ceci d’une manière indélébile, sinon je ne m’explique pas comment je suis devenu francophone. La seule manière de retrouver ma liberté totale, c’est de liquider ce contentieux, c’est de nous libérer des vicissitudes de l’histoire car c’est à partir de cette histoire commune que je raconte mes histoires.
C’est grâce à cette histoire commune qu'à chaque étape, j'ai essayé de retrouver une place dans cette société et cette place n'était autre qu'une interrogation nouvelle sur ma propre histoire. La seule manière d’y répondre a été de convoquer l'histoire au théâtre et de l'interroger publiquement. Car il s'agit avant toute chose de savoir de quelle histoire relève notre malheur. Et si le théâtre, c'est danser sur le malheur, avant de danser, il faut nommer ce malheur. Et à ce moment, j’ai l’impression de ne pas être compris par les Français. Cette incompréhension par les Français constitue déjà la première barrière à l’universalité. On n’a pas le «label rouge» Quand je suis arrivé en France, la première pièce que j’ai voulu monter était Le conseil de discipline.
Ce que raconte la pièce :
«Fin mai 1959, dans un collège de l’Est algérien. Au cours d’une dispute, Jacomino a blessé Atmourt d'un coup de couteau. Un conseil de discipline est décidé. Vu la situation politique et les tensions qui règnent un peu partout, tant dans la ville qu'au collège, le proviseur craint que ce conseil de discipline ne dégénère en bataille rangée. Afin de prévenir les affrontements, il organise une rencontre, qu'il voudrait conviviale, et y invite six professeurs, représentatifs des différentes tendances, pour tenir une sorte de ‘’pré-conseil’’. Sultanat, Sisco, Mauzer, Tahar, Billard, Cohen et le proviseur se retrouvent donc dans une clairière, aux alentours de la ville, pour un étrange pique-nique.»
Cette pièce, parce qu’elle traite de la guerre de libération et malgré le soutien du Festival des francophonies de Limoges, plus de vingt metteurs en scène n’ont pas voulu y toucher, et c’est en Belgique qu’elle fut réalisée.
Quand je parle de ma société dans l’espace de la langue française, il y a globalement deux attitudes :
- La première, je considère que les deux espaces sont isomorphes, qu’ils ont les mêmes limites, les mêmes libertés, la même densité. A ce moment toute critique de ma société est accablante et toute générosité à son égard est ridicule. Parce que mon regard est extérieur à ma société ou plutôt son point de départ n'est pas dans le centre de ce qui fait l'objet de mon discours. Je ne suis pas dans l’œil de mon cyclone. Mais j’aurais parlé de moi dans les codes de la langue française pour un lectorat français. Pour plusieurs raisons, les Algériens n’y ont pas accès du tout, d’autant plus qu’elle ne leur parle pas. La littérature africaine existe comme elle peut en France, mais en Afrique, on ne sait pas ce qui se crée, puis s’édite à Paris.
Ainsi, nous écrivons des livres où nous parlons d’une société qui ne nous lit pas et ils sont vendus dans une société qui à la limite s’en fout. Quelle est notre utilité ? Je me le demande.
- La seconde attitude est de tenter de rester soi, dans les limites de notre société, et prendre dans la langue française juste les mots pour dire sans se référer à elle ; à ce moment, on est auteur mineur pour la langue française.
Comment être totalement moi dans une langue qui n'est pas totalement moi ? Comment prendre l’envol nécessaire ?
La langue française est magicienne, elle me séduit, elle est ciselée depuis des siècles par des talents, elle vous happe, vous imbibe, on a beau se défendre on finit par céder à l’ivresse de sa beauté, tout en étant malheureux d’être sur la défensive. On s'égare longtemps pour dire un mot qui puisse ressembler à une parole, qui serait le début d’une écriture. Qu’est-ce qu’être auteur si ce n’est faire vivre autrement la langue que j’utilise et la poursuivre jusqu’à lui faire dire ce qu’elle n’a jamais dit autant dans la forme que dans le contenu ? Comme dit Mme Barbara Cassin : «Une langue, c’est des auteurs et des œuvres, c’est-à-dire une vision du monde.» Dans ces conditions, je n’ai pas une vision du monde, je suis bloqué à une vision des langues.
La langue française me séduit à me faire dire que ma mère n’est rien, parce que la référence du tout est ailleurs. Est-ce que ma mère est rien ? Pardonnez-moi mais je ne le crois pas… Ma mère peut être le rien de beaucoup de «tout», je n’en disconvins pas et je ne le nie pas. Ce qui m’intéresse, ce qui me pousse à écrire, c'est la recherche de son tout à elle. Seul idéal psychanalytique que je connaisse sans lequel toute écriture est vaine.
Écrire, c’est se réfléchir, c’est se projeter dans l'imaginaire avec comme seule certitude notre naissance et avec comme espoir toujours une renaissance pour un monde meilleur. Comment renaître dans le doute de sa naissance ? En tant que francophone, je me considère enfant adoptif qui, à un moment, doit trouver réponse à sa naissance. En conclusion, la francophonie est comme toutes les politiques, elle ne tient pas ses promesses. Et d’abord qu’est-ce qu’elle nous a promis ? A vrai dire, rien ! Donc c’est une politique qui ne promet rien. La liberté et aliénation francophonique relève d’un paradoxe, la langue française nous donne une distance par rapport à notre société et c’est là que s’inscrit la liberté. Mais cette distance est trop grande, elle modifie fatalement notre regard sur nous-mêmes, et ça c’est aliénant. Sur le plan culturel, elle est une grande ouverture ; sur le plan de notre relation historique, elle demeurera dans notre imaginaire, la blessure par laquelle nous sommes contraints de dire toutes nos autres blessures. La difficile coexistence des langues durera tant qu’on n’aura pas résolu notre problème avec l’histoire et qu’on «trimbalera» nos diverses langues comme des tares et comme les pires de nos ennemis. Pour moi, c’est grand dommage et en tant qu’écrivain, c’est une vraie douleur. Mis sur le banc de deux sociétés, celle du départ et celle de l’arrivée, on devient un regard libre. Notre projection dans le temps se mesure en unités d’existence et non d’appartenance. Nous sommes obligés de nous dépecer de nos douleurs pour pouvoir encore lire le malheur qui nous entoure. Je troque ainsi mes douleurs d’homme contre des joies d’artiste. Nul n’est exempt du malheur, et rares sont les artistes heureux.
S. B.
(*) Dramaturge
Source:
Brève adresse à un naturalisé honteux
Par Abdellali Merdaci (*)
Algérie Patriotique, le 28 mars 2018
Vous nous avez quittés, muni d’un titre de passage de frontières et de long séjour de l’ambassade de France à Alger. Une résidence d’écriture en province. Et, certes, à cette époque, vous n’étiez pas le seul. C’était en 1993, un terrible millésime. La France accueillait et protégeait sereinement les tueurs islamistes et, aussi, leurs probables victimes. Vous en étiez donc, Slimane Benaïssa, ni tueur ni victime, mais fieffé chasseur d’aubaine. Les raisons de votre migration vers le nord étaient, pour vous, claires et celles de votre retour dans ce qui était votre pays ne devaient pas, pour nous, l’être moins. Ne cherchez pas le refuge d’un faux débat sur l’altérité ; c’était une séparation. Car le mot «exil» n’existe pas dans votre maigre glossaire. Vous êtes resté en France et vous vous êtes fait naturaliser français : vous avez «réintégré» ce qui vous fut une mère-patrie d’antan et ses douces commodités, celle que vous chérissez plus que votre «mère biologique». Mais, contrairement à beaucoup de vos comparses qui proclament leur totale francité, à l’image d’un Anouar Benmalek, vous êtes un Français honteux. Vous vous cachez, craignant le vif opprobre.
Comme vous ne serez jamais reçu dans un journal français pour semer vos sombres et tardives billevesées, vous les étalez sur trois pages dans un quotidien algérien. Sans doute, dans un pays de jeunes, les lecteurs de ce titre qui ont plus de cinquante ans vous connaissent un peu, qui se remémorent le comédien, votre profession principale. A aucun moment de votre infinie et ridicule logorrhée philosophico-analytique sur un incernable Autre, vous ne leur concédez l’essentiel, ce qui est nécessaire à la compréhension de votre ruineuse et nauséeuse tirade. C’est à partir de votre position de «mtourèze» que vous construisez un inquiétant argumentaire de survie après un quart de siècle accompli dans la nationalité de l’ancien colonisateur, celle que le peuple algérien a expurgée par une sanglante guerre d’indépendance (1954-1962) et par son vote unanime, le 1er juillet 1962, pour une patrie retrouvée. Vous pouvez cracher sur cette Histoire qui n’est plus la vôtre : vous avez été retourné, revêtu des oripeaux du «m’torni» de sinistre mémoire, dans une accablante version néo-indigène.
Né sujet français, élevé à la citoyenneté française dans une vaine politique coloniale de la vingt-cinquième heure, Algérien par filiation à l’indépendance, vous êtes donc «retourné» à la France, ce qui est votre droit. Et vous n’en ignorez pas le protocole aisé, indiscutable : Français par «choix individuel». Comme l’exigeaient les sénatus-consultes (1863-1865) de l’Empire et, désormais, les lois de la République française. Mais, de grâce, foutez-nous la paix. Trois pages de «chiens écrasés» valent mieux que vos aveux. Les Algériens ne vous demandent rien, alors que vous en attendez tout. Vous êtes encore là, à l’affût pour grappiller, toute honte bue, des rôles dans le cinéma algérien et aussi, pourquoi pas, des hommages publics nationaux, comme votre compatriote naturalisé Merzak Allouache, ami du sionisme international, gratifié au printemps 2017 par l’Etat algérien de la médaille du Mérite national, qui, comme vous, n’a plus depuis longtemps aucune attache avec le pays et la nation. Probablement, une erreur de casting, mais elle ne vous empêche pas d’y croire, malgré que vous ayez depuis si longtemps coupé et piétiné le lien national.
Comme Anouar Benmalek – décidément ! –, vous n’hésitez pas à prendre ce qu’il y a encore à prendre dans un pays que vous avez en toute conscience abandonné lorsqu’il tombait en quenouille sous les coups de boutoir de l’islamisme armé, l’enlevant voracement de la bouche de ses enfants méritants. Pour vous et pour vos semblables, ce n’est jamais assez. Où est l’éthique ?
En 1993, vous vouliez vivre parce que Tahar Djaout, Abdelkader Alloula, Youcef Sebti, Salah Fellah, Azzedine Medjoubi, mais aussi des dizaines de milliers d’Algériens sont tombés sous les balles assassines de l’AIS, des GIA et des «katibate» de toutes obédiences barbares. Vous ne vouliez pas résister, mais prendre le large, réintégrant – c’est, en effet, le terme juridique idoine – la nationalité française au moment où des Algériens mouraient. Laissez-moi vous parler de mes amis du Théâtre régional de Constantine, listés sur de funèbres affiches accolées dans les mosquées du Bardo et d’Aouinet El-Foul, condamnés à mort par d’inattendus tribunaux de la foi, leur sang licité, guettés aux aubes muettes. Ils n’étaient pas, en ces années 1990 comme aujourd’hui, moins grands que vous prétendez l’être. Ils gardèrent les murs de leur théâtre, montant sur scène à l’heure antique de tous les sacrifices. Ils résistèrent, cousant chaque jour une taie d’espoir. Et avec eux, sur tous les tréteaux de fortune du pays, les corps noirs de comédiennes et de comédiens hallucinés, accrochés à des lendemains sans sang et sans deuils : leur théâtre ne s’est pas tari. Ils jouaient à tromper la mort ; c’était-là leur honneur inaliénable. Et, à leur image, de centaines de milliers d’Algériens anonymes présents à leurs postes de travail pour maintenir, vaille que vaille, leur pays debout, malgré les écoles détruites, les routes assiégées, les usines saccagées, les terres calcinées. Ils n’ont pas abdiqué devant la violence islamiste. Vous avez déserté, face à la mort et au malheur, pour sauver votre peau et profiter d’une impénétrable ligne de crédit de l’obscure diplomatie française. Lorsqu’on a traversé la mer non pas pour le respectable exil qui a formé les Grands Esprits, la décence aurait été de ne point en rajouter, simplement de vous taire.
Et voilà que vous nous revenez, sans un mot de remords, sans contrition, en criant sur les toits. Comme si vous étiez toujours de cette famille de Veilleurs d’espérances, que vous avez répudiée pour aimer et apprendre à aimer, vous le scandez dans votre confession, une Autre. Alors, vous vous emparez de la posture du maître pour nous enseigner le vain couplet des Pleureuses de l’ancien temps, qui ne reviendra pas. Vous vous complaisez à suriner cette complainte du néocolonisé miséreux, s’agenouillant devant la sacro-sainte France et sa langue. Vous nous bassinez ce couplet, maintes fois entendu depuis Senghor pour devenir rébarbatif, de la langue française dispensatrice de liberté. Vous secouez cette fumeuse potion d’une «pluralité» et d’un «métissage» circonstanciés, pour en fin de course vous découvrir français. Car cette «pluralité» et ce «métissage», lourdement invoqués, ne sont que le déni de la nationalité algérienne originelle qu’il vous faut noyer dans le putrescent alambic de certitudes avariées.
La France a fait de vous un «métis», subjugué par sa langue. Vous ne le seriez pas si vous étiez resté en Algérie pour revivifier votre habituel répertoire de théâtre en arabe dialectal et vous n’auriez pas été requis d’apporter de bruyants gages de fidélité et d’assimilation réussie par la langue au pays qui vous a enrôlé dans ses empressées harkas, aussi amorales que le furent celles de la guerre anticoloniale, tirant dans le dos des Innocents.
Mais voilà que vous vous interrogiez, après avoir égrené à longueur de colonnes du Soir d’Algérie vos indigestes palinodies d’Arabe français, sur la destinée des écrivains qui vous ressemblent. Vous vous alarmez de tous ces écrivains d’ailleurs édités en France et squattant ses librairies et ses salons littéraires : «Comment les nommer ? Où les placer ? Comment les classer ?» En ce qui vous concerne, vous ne cultivez pas le doute. Vous vous situez à la suite d’«une génération d’écrivains qui nous ont précédés, celle de Kateb Yacine, Mohammed Dib, Malek Haddad, Mouloud Feraoun». Or, cela est vérifiable : aucun de ces écrivains n’a opté pour la nationalité française après l’indépendance, comme c’est le cas pour vous. Vous avez choisi d’être français, vous ne pouvez plus revendiquer, et c’est valable pour ceux qui ont suivi le même chemin que vous, une appartenance à la littérature algérienne qui n’est ni un bordel en rase campagne ni un miteux hôtel pour demi-soldes de la France littéraire.
Entendons-nous : ne sont dignes de la littérature algérienne et de la nationalité littéraire algérienne que ceux et celles qui portent l’histoire passée, présente et à venir de leur nation, dont vous vous êtes volontairement exclu, par «choix individuel», il convient de le répéter. Français, vous devez vous battre pour vous faire reconnaître dans la littérature française, la littérature de votre pays, car c’est une vérité universelle que la littérature affleure dans le corpus national d’un Etat libre et indépendant, avant d’atteindre l’universalité. Shakespeare, c’est l’Angleterre, Cervantès, l’Espagne, Goethe, l’Allemagne, Voltaire, la France, Dante, l’Italie, Tolstoï, la Russie. Ne prétendez pas incarner la littérature des Algériens ; ils ne vous ont pas sollicité pour être leur interprète auprès de la France dont ils n’ont cure. Vous devez vous convaincre que le «vécu algérien» vous échappe, parce que vous êtes un Français, de Paris ou de Nogent-le-Rotrou, peu importe.
Pourtant, il vous arrive d’être lucide. Pour diverses raisons, vous n’excluez pas la possibilité de n’être qu’un «auteur mineur» et de produire une littérature désemparée, sans lecteurs et sans perspectives, incompris dans votre pays d’adoption. En un quart de siècle de nationalité française, vous n’avez pas changé le visage de la France. En retour, vous avez outrageusement zingué le vôtre à l’horizon de cruelles illusions. Cela est si vrai que la France littéraire vous néglige, nonobstant vos «In» à Avignon. Vous ne serez jamais élu à ses grands prix littéraires ni coopté dans ses académies, ni comme Alain Mabamckou, autre «zingueur de face» à votre façon, invité dans sa plus prestigieuse institution universitaire pour exhaler le sanglot de l’Arabe peinturluré de vernis de civilisation française.
Si la France ne vous attend pas et ne vous a pas attendu, l’Algérie vous a oublié. Votre drame, vous le résumez parfaitement : vous êtes «le fils d’une histoire», assurément française, qui ne vous a rien donné. Il aurait mieux valu pour vous rester celui de vos parents biologiques. Algérien et Français, éveillant en vous la défunte Algérie française, vous vous autorisez l’imparable prophétie. Vous prédisiez, au tournant des années 2000-2010, que l’idée de nation algérienne s’effilochait en raison de ceux qui vous ont imité, trop nombreux à votre gré : «Si l’Algérie continue comme ça, elle deviendra française par choix individuels.» (Cf. Séverine Labat, La France réinventée. Les nouveaux binationaux franco-algériens, Paris, Publisud, 2010, p.173). Aujourd’hui comme hier, le pays ne s’est pas vidé de sa population et les fondations de la nation algérienne restent inébranlables. Dix ans après, l’Algérie n’est pas devenue française ; elle s’est, salutairement, débarrassée de ses dernières légions de soldats perdus, semblables à ceux de l’An VII de la Révolution, jetés dans les décombres fumantes de la trahison et l’ignominie.
Ce qui transparaît, de manière évidente, dans votre monologue de «métis», obstinément théâtreux, cherchant éperdument les ultimes feux de la rampe, c’est l’insurmontable fêlure d’une identité algérienne niée, torturant de ténèbres votre parcours de Français dissimulé. Ni votre philosophe de café du commerce ni votre «psychanalyse pour les nuls» n’endigueront le désarroi d’un quart de siècle de reniement.
A. M.
(*) Professeur de l’enseignement supérieur. Écrivain et critique
Source:
Franches explications pour clore un débat (I)
Par Abdellali Merdaci (*)
Algérie Patriotique, le 4 avril 2018
Ce débat que j’ai proposé sur le positionnement du comédien et écrivain français d’origine algérienne Slimane Benaïssa relativement à une culture de «métis», pensée, vécue et assumée pendant un quart de siècle de vie en France sous la couverture juridique de la nationalité française, obtenue en 1993 par la procédure de la «réintégration», n’a pas été inutile. Il s’est prolongé dans d’imprévues incriminations et a suscité la réaction de plusieurs dizaines de lecteurs d’Algérie patriotique, réagissant parfois sous le sceau de l’anonymat, le plus souvent à charge contre l’auteur de ces lignes. Et, aussi, d’acteurs des champs culturel et intellectuel algériens intervenant ès-qualité. Notons que celui qui est directement mis en cause, promu par le gouvernement de M. Ouyahia à l’éminente responsabilité du Festival international du théâtre de Bejaia, se tait.
On m’aura reproché de m’être focalisé sur le comédien et écrivain français d’origine algérienne Slimane Benaïssa et de ne pas évoquer le cas des ministres binationaux du gouvernement, qui n’ont pas manqué dans le cas de certains d’entre eux de se présenter devant la presse nationale comme des «coopérants techniques». Ils existent, certes, et prennent la place d’avérés militants de partis du pouvoir. Mais, il n’a jamais été dans mon objectif de faire un quelconque procès de la bi-nationalité et toutes les bi-nationalités ne se valent pas. Je ne connais pas de bi-national qui ait aussi passionnément milité pour l’Algérie, son premier pays, que mon estimé ami Ahmed Bensaada, physicien, didacticien et écrivain algéro-canadien, revenu servir l’Université algérienne et ses étudiants, apportant régulièrement dans ses écrits son tribut à la culture nationale algérienne. Entre l’Algérie et le Canada, il n’y a pas d’équivoques de l’Histoire ; il n’y en a pas avec la Grande-Bretagne, les États-Unis d’Amérique, l’Australie, la Russie, la Chine et tous les pays du monde sans exception aucune.
La France restera toujours la puissance colonisatrice qu’elle a été. Aucun traité d’amitié n’effacera les ruines de ses généraux de la conquête, ses enfumages et ses génocides et ne dissipera les effets de cent-trente-deux années de soumission. La séparation de l’Algérie d’avec la France a été la plus violente de tous les pays de son défunt domaine colonial. Une guerre sanglante de sept années et un vote massif d’autodétermination des Algériens ont rompu définitivement le joug colonial français.
Le choix de la nationalité française pour un Algérien est toujours politique en ce sens qu’elle est une survivance et une légitimation de l’Algérie française, et le faire, dans les années 1990, au moment où le pays était à terre, est abject. Il trahit le contrat moral d’un peuple et le sacrifice de centaines de milliers de ses enfants. C’est Slimane Benaïssa qui prédisait dans l’enquête de Séverine Labat (La France réinventée. Les nouveaux binationaux franco-algériens, Paris, Publisud, 2010) que l’Algérie redeviendrait française par le choix individuel de ses habitants d’opter pour la nationalité française – ou de la réintégrer. N’agitait-il pas dans ce propos les oripeaux de la politique néocoloniale de la France ?
De l’introuvable exil à la curée des grappilleurs
Je voudrais lever une ambiguïté qui apparaît dans certaines réactions. Je ne connais pas Slimane Benaïssa et je ne l’ai jamais rencontré. Je n’ai personnellement aucun contentieux – caché – à régler avec lui. Je n’appelle ni à une «déchéance de nationalité», l’intéressé s’étant déchu lui-même de sa propre initiative, ni au «meurtre rituel» et à la «lapidation publique», sornettes d’un autre temps. Voilà donc que des binationaux masqués, qui ne peuvent exciper que de la pleutrerie de l’anonymat, secourant leur frère de turpitudes, convoquent les nuées du martyrologe, qui sied si mal à Slimane Benaïssa et à ses agapes françaises.
Ce qui est, de mon point de vue, fondamental dans ce débat, je l’ai dit dans ma première contribution («Brève adresse à un naturalisé honteux, AP, 28 mars 2018), c’est le mépris affiché par Benaïssa envers les Algériens et leur culture nationale dans un interminable texte de trois pages dans le quotidien Le Soir d’Algérie (20 mars 2018) où il justifie, en recourant à un gribouillis prétentieux de philosophie et de psychanalyse buissonnières, une démarche individuelle de naturalisé («mtourèze», «mtorni»), induisant, pour lui, une rupture nécessaire d’avec la culture de ses géniteurs biologiques. Il reconnaît ainsi la France comme nouvelle mère, au sein nourricier, faisant prévaloir un regard différent sur son passé. C’est sur cette posture nodale du changement de culture et de nationalité que j’avais répondu à Slimane Benaïssa, dressant son bilan d’un quart de siècle dans la francité (1993-2018), à partir de ma position d’universitaire algérien, loyal envers mon pays, formant pendant et avant cette période des milliers d’étudiants dans mes spécialités d’enseignant-chercheur en linguistique et en littérature, publiant quinze ouvrages et des dizaines d’articles dans des revues scientifiques et des journaux, tout en étant suffisamment présent et engagé dans le débat culturel national. Et, justement, dans ces années 1990 de toutes les ruptures, au devant des menaces et des risques quotidiens d’une guerre civile.
Alors, allons à l’essentiel. Bien entendu, au-delà de Slimane Benaïssa, tout Algérien a le droit de mener sa vie comme il l’entend et, partant, de changer de nationalité et de patrie. Ce n’est pas ce droit que je conteste. Je reste respectueux envers ces anciens Algériens, à l’étroit dans leur pays natal, qui ont émigré dans le vaste monde, sans y retourner en donneurs de leçons. Français, Benaïssa aurait dû vivre sereinement sa vie dans sa nouvelle patrie sans revendiquer l’ancienne, en raison même des conditions de son départ d’Algérie et de sa coupure du lien national. Il raconte lui-même dans quelles conditions il a été exfiltré, en 1993, vers la France par les services de l’ambassade de ce pays. Je renvoie les lecteurs d’Algérie patriotique, dans l’ouvrage cité de Séverine Labat, aux déclarations du comédien néo-français et à celles d’autres naturalisés bien connus de la scène culturelle, médiatique et scientifique algérienne. Ces naturalisés ont profité de l’état de guerre civile fomentée par l’islamisme armé en Algérie, pour partir à l’étranger, particulièrement en France, avec l’objectif de s’y installer définitivement, de changer de nationalité et de patrie. Ils le disent sans ambages. Pourquoi reviennent-ils en Algérie pour enlever des places et des récompenses qu’ils n’ont pas gagnées en France ?
Il se pose ainsi une question de sens des mots : ces candidats à la migration en France ne relèvent pas de l’image surannée de la «ghorba», autrefois chantée avec émotion par Aïssa Djermouni et Slimane Azzem, ni de l’exil. Comme le spécifient les dictionnaires de langue française, consultables par tous, le mot «exil» renvoie à la contrainte qui frappe une personne «obligée de vivre loin de sa patrie» ou du lieu où, «habituellement, elle aime vivre». Il y a des exils exemplaires : Lénine, Ho-Chi-Minh, Gandhi, Neruda et bien d’autres, n’ont pas vendu leur attachement à leur nation pour un plat de lentilles. L’exil – on l’a observé chez plusieurs acteurs du champ politique algérien, singulièrement Aït Ahmed, Boudiaf, Ben Bella, Mahsas – peut s’inscrire dans la durée et il n’implique pas un changement radical de statut juridique. Plusieurs personnalités politiques, contraintes à l’exil pendant les présidences de Houari Boumediene et de Chadli Bendjedid, sont rentrées dans le pays après Octobre 1988 et l’ouverture du champ politique pour y reprendre leurs activités partisanes. Sans aliéner le nom de leur patrie et leurs convictions politiques.
Lorsque j’avais écrit et proposé ma réponse à Slimane Benaïssa à la rédaction d’Algérie patriotique, j’ignorais sa nomination en qualité de commissaire du Festival international du théâtre de Béjaïa par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, communiquée le 28 mars 2018 par un quotidien national. Je me devais de répondre à cette situation scandaleuse en publiant une «Mise au point» (AP, 30 mars 2018) dans laquelle je manifeste résolument ma réprobation d’une nomination indue. Si cette nomination est une récompense du gouvernement, elle devrait consacrer dans la famille du théâtre algérien un(e) professionnel(le) qui n’a pas baissé les bras devant la barbarie islamiste, qui, en toutes circonstances, n’a pas compromis les chartes de son pays.
Ceux qui ont quitté le pays pour la France, dans les années 1990, au plus fort de la guerre civile, l’ont fait pour des motivations exécrables. Envisageons les choses sereinement : lorsqu’on a nourri l’hypothèse du pire pour le pays que l’on a abandonné, comment peut-on ambitionner un quart de siècle après d’y convoiter des responsabilités ?
A. M.
(*) Professeur de l’enseignement supérieur. Écrivain et critique
Source:
Information complémentaire
Slimane Benaïssa commissaire
Le Soir d'Algérie, le 28 mars 2018
L’homme de théâtre Slimane Benaïssa a été désigné par le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, en qualité de commissaire du Festival international du théâtre de Béjaïa. Le festival, qui accueillera des troupes de plusieurs pays, se déroulera du 29 octobre au 4 novembre 2018.
D’un pays à l’autre, d’une langue à l’autre. Où se situe l’exil ?
Par Slimane Benaïssa (*)

Qui est l’autre ?
Celui qui a une couleur de peau différente de la mienne ? Celui qui est d’une religion différente, de sexe différent, de nationalité différente, de culture différente ?
Qu’est-ce que l’autre ? L’autre, avant d’être une différence, est avant tout et en grande partie une ressemblance. Car on ne peut comparer, en positif ou en négatif, que des choses qui se ressemblent.
Pour accepter ou rejeter un individu, il faut qu’il soit totalement comme nous, à une différence près. Le paradoxe est que cette différence devient le tout et le tout qui nous ressemble devient une quantité négligeable. Et certains oseront affirmer que cette infime différence détermine le tout !
Si on s’arrête à cette définition de l’autre, on ouvrira la porte à toutes sortes de discriminations qui répondent à la simple équation : il est différent, donc il mauvais ; il est différent de moi qui suis le bien, donc il est le mal.
«Autre» avant d’être un pronom indéfini, un adjectif, est philosophiquement défini comme «catégorie de l’être et de la pensée qualifiant l’hétérogène, le divers, le multiple».
Et là, je citerai une manière chez les Arabes d’introduire l’enseignement de la philosophie ; ils instruisent le débutant sur la notion de philosophie par l’anecdote suivante : deux frères jumeaux qui, pour se différencier, portent chacun un tarbouche différent. Un matin, l’un des deux se réveille et met le tarbouche de son frère. En se regardant dans le miroir, il se dit : «Si maintenant je suis mon frère, alors qui suis-je ?» Cette question est le début de la philosophie.
On voit bien qu’on ne peut s’interroger sur l’autre sans s’interroger sur soi-même, ce qui nous mène tout droit à la troisième définition de l’autre, la définition psychanalytique. Selon Lacan : «L’autre est le lieu où se situe un au-delà du partenaire imaginaire, ce qui est intérieur et extérieur au sujet et le détermine néanmoins.» On passe à travers les différentes définitions de l’autre, de l’adjectif qui mène au rejet en passant par la définition philosophique qui mène à l’interrogation sur nous-même et la définition psychanalytique qui définit l’autre comme quelque chose qui me détermine. Donc l’autre est en moi.
La meilleure façon de considérer l’autre, c’est d’être l’autre, de vivre avec l’idée que l’autre c’est tout simplement moi. L’autre est en nous ! Si l’autre est en nous et que nous sommes les autres, alors on est enclin à se poser la question que se pose le deuxième frère : qui sommes-nous ?
Ce NOUS qui peut être collectif ou individuel est déterminé par notre propre histoire. Nous évoluons ou nous régressons, selon les cas, en fonction de notre histoire.
Comme chaque individu, société, communauté a une histoire différente et dans beaucoup de cas opposée à celle de l’autre, sinon antagoniste, comment ces sociétés vont-elles construire leur paix ? En tout état de cause, ce n’est ni en additionnant toutes les histoires ni en exhibant les douleurs engendrées, ou les gloires obtenues. L’histoire, malheureusement, est une suite d’événements justes ou injustes sur lesquels nous ne pouvons plus agir, mais, au contraire, nous devons les considérer telles qu’elles sont, quelle que soit la douleur, quelles que soient les injustices. Nous n’avons sur l’histoire qu’un seul pouvoir, celui de la lire et de la relire pour comprendre ce qui s’est réellement passé et cette compréhension constitue la mémoire. La mémoire est en quelque sorte constituée de notre compréhension de notre histoire et de l’analyse qu’on fera des événements à travers le prisme de nos valeurs.
Les mémoires, contrairement à l’histoire qui nous enferme, peuvent fusionner entre elles et construire de nouvelles mémoires qui intègrent celles des autres. C’est pour cela qu’il est important que la mémoire soit l’émanation de la vraie histoire ; si on déforme l’histoire, la mémoire sera mal nourrie et inopérante pour l’évolution des sociétés. Si nos histoires respectives nous séparent, nous éloignent, les mémoires peuvent nous rapprocher, nous unir.
J’ai été élevé et j’ai grandi dans quatre langues : l’arabe dialectal, le tamazight, le français et l’arabe classique. La question de l’autre était en principe résolue en moi, puisque mon MOI était fait d’autres, puisque l’altérité ne peut être concevable que dans un cadre pluriel. Mais pour beaucoup d’Algériens, l'autre non conflictuel ne peut être qu'étranger… Et je commencerai par une citation de la sociolinguiste Amina Aït-Sahlia qui écrit dans un article en 1999 : «L’autre en discours» : «Reconnaître la part d'autre dans un même, c'est aussi reconnaître en soi sa part d'autre. Plus que la crainte de reconnaître l'autre en tant que tel, c'est aussi peut-être la crainte d'être déstabilisés que redoutent les Algériens en reconnaissant l'autre en eux-mêmes. N'est-ce pas la crainte de se retrouver étrangers à eux-mêmes ? Et pourtant... Moi-même et tous les Algériens sommes tous le résultat de siècles de brassages culturels. Nous sommes tous inévitablement porteurs de notre part d'autre.»
Les communautés ou les sociétés comme l’Algérie revendiquent l’altérité vis-à-vis de l’extérieur et la refusent à l’intérieur. Cette double relation à l’altérité est contradictoire et dangereuse en cas de conflit. Étant tous les mêmes en tant qu’éléments d’une même communauté, nous avons les mêmes différences et nous devons avoir les mêmes agissements vis-à-vis de l’autre extérieur. C’est ainsi que n’importe quel Arabe peut venger n’importe quel autre Arabe. La négation de l’altérité à l’intérieur par la négation de la pluralité multiplie à l’infini les conflits avec la pluralité extérieure.
Voici dans quel esprit j’ai reçu l’héritage de ma pluralité et le pétrin dans lequel a fermenté la pâte de mon métissage. J’ai compris que je devais défendre la pluralité, qui me définit sur tous les fronts.
Expérience algérienne
Au théâtre, j’ai choisi de m’exprimer en arabe dialectal qui est la langue maternelle de la majorité des Algériens et représentative de son histoire. Elle a drainé toutes les influences qu’a connues le peuple algérien : berbère, romaine, turque, arabe, française. Elle est à ce titre une référence sûre. C’est dans cette langue que le public algérien s’entend, qu’il se comprend, qu’il veut débattre et évoluer.
Cette langue étant une langue d’oralité, elle a une structure dont le centre est la mémoire et la mémorisation. Elle est organisée de manière à ce que tous les récits développés soient mémorisés à l’écoute. La culture orale développe à cette fin d’innombrables techniques :
Elle possède, entre autres, deux grandes qualités qui me permettent de dépasser tous ces conflits linguistiques et me servir de point d’appui pour créer une langue pour le théâtre :
Sa première qualité est d’avoir su dépasser les limites du discours social à travers un langage par sous-entendus que les poètes et les narrateurs, qui ne pouvaient pas tout dire en public, ont développé.
Sa deuxième qualité est d’avoir su déjouer la censure coloniale à travers des codes de communication développés par les orateurs.
Face à cette double répression, morale et politique, la langue n’était plus dans ses mots, elle n’était plus dans ce qu’on entendait, mais dans ce qu’elle sous-entendait.
Par ailleurs, à l’école française, j’ai appris que le théâtre ne se réalisait pas totalement dans ce qui est dit, mais dans le non-dit. J’ai tenté alors d’élever les sous-entendus de la langue maternelle à la force des non-dits pour construire une langue pour le théâtre algérien. A un moment de cette expérience, j’ai compris que cela ne suffisait pas, parce que le sous-entendu était une construction qui se développait sur les images. A partir d’une image, on suggère une autre. Ce procédé déguise la langue mais n’apporte pas du sens, il favorise la redondance, alors que le non-dit surfe justement sur le sens. On développe un sens audible, qui ouvre la porte sur plusieurs sens non-dits, et ces non-dits prennent tout leur sens dans l’imaginaire du public.
Toutes ces techniques, une fois libérées de la problématique de la mémoire, deviennent des outils dont on se sert pour faciliter l’écoute au théâtre et nous offrent différents registres au service de l’écriture dramaturgique. L’arabe dialectal a subi l’influence de l’arabe classique qui est intimement lié au Coran. Il fallait le laïciser, le libérer de son contenu systématiquement religieux et en faire une langue qui parle simplement de l’humain. On ne peut atteindre notre public qu’en arabe algérien, mais cette langue a l’expérience et les limites culturelles de ceux qui la parlent. La seule issue pour nous, dramaturges, était de faire évoluer la langue elle-même. Mais compte tenu de l’évolution sociale rapide, la langue dialectale, bousculée par la réalité industrielle et technologique, se trouve acculée à un enrichissement anachronique et s’exténue. Il fallait lui éviter cela… Mais on ne fait pas penser une langue, c’est la langue qui nous fait penser. Conscients de cela, on comprendra aisément que toute pensée nouvelle s’affronte en premier lieu à l’outil linguistique. Une idée nouvelle qui s’affronte à un code traditionnel ne peut s’imposer qu’en créant un code à sa mesure, partant du premier et se référant à lui. Nous poussions la langue dans ses limites naturelles tout en essayant de tracer des limites à nos idées acquises ailleurs et qui, elles, étaient sans limite. L’arabe dialectal devait évoluer afin de devenir une langue nationale. A notre niveau, tout en inventant un théâtre, nous avons forgé cette langue en brassant les régionalismes linguistiques, nous avons participé à la création de notre langue nationale.
Nous avons perdu beaucoup de temps et d’énergie à redonner à chaque langue sa juste valeur, sa juste place, dans un contexte politique hostile qui manquait de vision et de sérénité à l’égard de toute forme de pluralité. Il est important de signaler qu’au vu de la situation conflictuelle dans laquelle se trouvaient les différentes langues, le fait de choisir telle ou telle langue pour s’exprimer publiquement constitue une posture politique en soi, car dans ces conditions de guerre des langues, le choix d’une langue par rapport à une autre a une signification politique. C’est pour toutes ces raisons que la langue n'est pas pour moi un simple outil que je façonne, que je perfectionne, elle est le fantôme qui hante mon histoire et par laquelle il me faut rêver. Je ne porte pas ma langue maternelle, je suis porté par elle. Je porte la langue française et je suis emporté par elle. Telle est l’équation de mon bonheur de métis, au-delà des malheurs de mon histoire et des miens.
C’est à travers cette histoire, qu’elle soit belle, sereine ou conflictuelle, que nous avons dit notre peuple avec les colères qui sont les siennes, avec la pudeur qui est la nôtre, et parfois avec les maladresses des poètes errants que nous sommes, dans un monde où il est souvent ridicule d’expliquer et douloureux de se taire.
L’Histoire des «Nôtres» a forgé notre esprit et notre imaginaire jusque dans l’intimité des métaphores. Le malheur a fait le poème, notre espoir est que la paix en fasse un chant.
Par ailleurs, étant le fils d'un pays qui ne cesse depuis des siècles de chercher sa paix, le début de ma paix est dans la paix des langues qui m’habitent et que j'apaise sans cesse pour les apprivoiser afin qu'elles puissent porter nos malheurs avec sérénité et oser la joie. L'apaisement de ces langues est un poème en soi, il est notre vrai talent.
Je dirais même notre unique talent, celui qui nous est prescrit par ordonnance testamentaire.
Les langues qui me traversent sont porteuses de toute mon énergie à dire et à écrire, quand elles sont en conflit à l’intérieur de moi, ma colère devient inaudible parce qu’aucune des langues n’ose la dire et je perds la voix. Quant à mon peuple, il mélange d’instinct l’arabe au français, le tout assaisonné de berbère, il cherche désespérément leur alliance pour dire sous une forme nouvelle ce qu’il ressent depuis toujours, parce que le peuple, malgré la misère, a horreur de se répéter face au malheur. Il crée pour se garder en estime.
Les langues écrites nous sont utiles certes, mais nos langues maternelles qui ne sont qu’orales nous sont vitales malgré tout, parce qu’elles nous déterminent. Elles sont l'espace de cette mémoire qu'on oublie et qui continue de nous transformer malgré nous. Les langues populaires naissent dans le peuple et s’épanouissent dans l’élite.
Les peuples, rarement heureux, ont très peu de mots pour dire le bonheur, trop de mots pour cacher la honte du malheur. Quand celui-ci n'est plus à cacher, il se tait. Et la langue s'atrophie, elle se noie dans les larmes, elle se fait clandestine dans les terreurs. Elle se fait petite parce qu'elle reconnaît son impuissance à dire autant de malheurs. Et nous sommes contraints de dire ce malheur comme gage de notre liberté.
De quelle liberté suis-je capable si je dois piétiner l’analphabétisme de ma mère et de mon père ? Eux qui souffraient déjà de leur ignorance parce qu’ils mesuraient ce qu’ils ne savaient pas. Je voudrais vous faire un aveu : à mon âge, et malgré tout ce que j’ai écrit, je n’ai écrit que l’analphabétisme de mes parents et je ne sais pas quand je commencerais à exprimer ma propre conscience du monde, quand vais-je pouvoir m’écrire.
Comment, dans ce chaos linguistique, arriver à créer un théâtre pour un public algérien et dans sa langue maternelle ?
Au bout de toutes ces tentatives, je ne sais comment, j’ai décidé, afin d’arrêter de tourner en rond, de faire en sorte que la langue soit le personnage principal de toutes mes pièces.
C’est-à-dire mettre en situation hors réalité des personnages pour qui il fallait inventer une langue, sinon ils ne sauraient pas dire ce qu’ils vivent et seraient incapables de dialoguer. Il fallait supprimer tous les référents culturels de la langue et l’obliger à assumer une situation inédite.
De cette façon, j’ai eu une plus grande aisance à travailler mes textes parce que j’ai libéré la langue de sa quotidienneté et l’ai inscrite dans un autre réel, là où elle ne s’est jamais risquée. Par cette démarche, c’est moi qui décide à quelle référence je rattache la langue, les références de la langue ne s’imposent plus à moi.
En fin de compte, quand l’idée d’une pièce me vient, je sais quelles idées je dois écrire dans ma langue maternelle et celles que je dois écrire en français. C’est le projet d’écriture lui-même qui me guide pour prendre la décision d’écrire soit en arabe soit en français. Ce qui détermine mon choix est très instinctif, mais il y a d’autres paramètres qui entrent en jeu pour justifier rationnellement ce choix.
J’ai longtemps cru que les deux démarches étaient totalement distinctes et séparées. J’essayais alors de me placer dans le cadre culturel de chaque langue pour trouver ma démarche théâtrale et dramaturgique. Pour moi, celle-ci était intraduisible d’une langue à l’autre et si je devais les traduire il n’y avait qu’une seule issue : réécrire. Je considérais que si moi j’étais bilingue, mes écrits n’étaient pas bijectifs et vice-versa.
Douze ans après avoir écrit Les fils de l’amertume, pièce sur l’intégrisme islamiste et la décennie noire en Algérie qui a été jouée en 1995 dans le «In» du Festival d’Avignon, j’étais convaincu qu’elle était intraduisible dans ma langue maternelle pour plusieurs raisons, dont deux principales. Je pensais d’abord que si je la traduisais, il fallait que je tienne compte des formules religieuses minimum, du code linguistique inhérent au discours religieux et sur la religion. Ce qui ferait dire à la pièce le contraire de ce que je voulais dire.
Ensuite, je pensais que pour décrire la société dans laquelle est né cet intégrisme, il fallait plonger dans ses profondeurs et fatalement bousculer ces codes moraux, éclater les limites du discours social jusqu’à la trahison, jusqu’à la dénonciation.
Pour toutes ces raisons, je pensais que cette pièce resterait à jamais intraduisible, du moins injouable, devant un public algérien, en arabe algérien.
Pendant 12 ans j’étais tourmenté par le fait qu’elle soit intraduisible parce que je ne voulais pas m’inscrire dans un théâtre d’exil. Si elle était inaudible pour le public algérien, j’avais trop honte d’avoir mal traduit ses malheurs au public français. Il me fallait une preuve qui légitime au moins mon rôle de passeur.
Jusqu’au jour où, revenant de Bruxelles, seul en voiture, alors que je ne pensais pas particulièrement à cette traduction, je ne sais pas par quelle démarche hasardeuse l’équivalent d’une réplique de la pièce en arabe algérien me traverse l’esprit. Je sors au prochain arrêt d’autoroute et je traduis de mémoire toute une scène.
C’était tellement juste et beau que j’en ai pleuré. Je suis resté trois heures dans cet arrêt, incapable de reprendre la route, comme si j’étais arrivé quelque part en moi. Je venais de retrouver ma langue maternelle cachée derrière la langue française et tellement intimidée par elle qu’elle m’a fait croire à moi, pendant 12 ans, qu’elle n’était pas là.
J’ai repris la route, unifié dans ma pensée et plus pluriculturel que jamais. Voilà un exemple où les deux cultures et les deux langues que je porte en moi fusionnaient parfaitement dans mon esprit pour dire aux Français ce que vivaient les Algériens. Est-ce la gravité des événements qui font l’objet de la pièce qui m’ont obligé à aller chercher en moi plus que la synthèse des langues et leur indépendance ? Est-ce la force des émotions qui me traversaient qui a chauffé à blanc les deux langues, les deux cultures pour n’en faire qu’une ? Est-ce le désir de porter à un public français la vérité douloureuse d’un vécu algérien qui a fait que les deux cultures se sont mêlées et que les deux langues ont tressé un seul et unique texte pour deux langues ? Je ne le sais pas.
Toujours est-il que, depuis ce jour, je suis convaincu que la littérature cache plus qu’une langue, comme l’art cache plus qu’un regard. La littérature et l’art sont pluriels par essence, il est regrettable d’avoir une seule culture pour lire et un seul regard pour voir.
Expérience française
La génération d’écrivains qui nous ont précédés, celle de Kateb Yacine, Mohammed Dib, Malek Haddad, Mouloud Feraoun, était inscrite au cœur même du combat pour l'indépendance et la langue française était l’outil idéal pour porter le combat en métropole. La problématique de la langue ne se posait même pas pour eux tant la nécessité, l'urgence de la lutte n'avaient pas le temps de discuter des langues à utiliser.
Mais aujourd'hui, après l'indépendance, nos politiques ont rejeté la langue française avec les valeurs qu'elle porte en elle, droit de l’homme, démocratie, etc., sous prétexte qu’elle était la langue du colonisateur. L’identité de la société algérienne allait se construire en dehors des valeurs de la culture française et c'est là où les choses se compliquent. Car l'amalgame a été fait entre valeurs, culture, identité et histoire.
Il est difficile de faire admettre à nos gouvernants, qu'on peut s'approprier la culture française dans ses valeurs et construire notre identité propre tout en réglant nos problèmes d'histoire avec la France.
C'est cette incompréhension qui nous a placé nous comme opposant naturel aux différents pouvoirs et nous a contraint petit à petit à un exil intérieur et qui a fini par devenir un exil vers l’extérieur.
Nous, dramaturges, avons été formés en français, certains en arabe classique, deux langues dont l’expérience n’est pas celle de notre langue maternelle. Comme dit Benjamin Stora : «La migration algérienne en France est marquée d'une double empreinte. Elle est à la fois héritière d'une tradition maghrébine et islamique, mais aussi du très long contact entretenu par les Algériens avec le colonisateur, qui leur a imposé sa langue comme moyen d'expression.»
Notre regard sur la réalité relève de nos connaissances, mais celles-ci furent acquises ailleurs. Nous regardons notre réalité à partir d’un espace extérieur à la langue avec laquelle nous devons communiquer. Un Français éduqué et formé dans sa langue maternelle (le français), quand il parle de la réalité française, il s’exprime parce qu’il y a dans son imaginaire une continuité linguistique et culturelle.
Quant à moi, quand je regarde la société algérienne pour en parler en arabe algérien à des Algériens, souvent je pense en français ou en arabe classique, pour dire en arabe algérien, ce qui fait que je ne m’exprime pas, je traduis. Parce qu’il y a discontinuité linguistique et culturelle due à ma formation. Cette discontinuité fait que je négocie les mots, je ne les invente pas, elle me pousse au compromis et là, soit je compromets la réalité que je veux dire, soit je compromets la langue que j’utilise. Je n’ai pas les angoisses du créateur, j’ai les aphtes du créateur réduit à se traduire.
Ajoutons à cela que les trois cultures, les trois langues, ne sont pas superposées et indépendantes dans mon esprit. Mon métissage n’est pas la somme des langues que je connais, il est une fusion des cultures en moi. Ma pluralité est une synthèse faite des trois cultures. De ce point de vue, mon regard est différent de celui de ma culture d’origine. Il est aussi différent de celui de mes cultures acquises.
Si je maîtrise la langue, cela ne veut pas dire que je connais suffisamment la société française pour pouvoir y exister comme homme de théâtre. Édouard Bond dit : «Le théâtre n'est pas une chose que l'écrivain crée en misant sur sa seule ingéniosité personnelle, c'est une activité sociale.»
En quittant mon pays, je me retrouvais en tant qu’homme de théâtre, doublement menacé d'exil territorial et d'exil professionnel. D’autant plus que c’est dans l'espace de théâtre que je reconstituais l’idée que je pouvais avoir de mon pays.
Pour pouvoir échapper à l’exil professionnel, il m'a fallu plonger dans la société française avec enthousiasme et grand appétit pour la connaître et me laisser imprégner d’elle. Il me fallait aussi l’aimer pour me donner le désir de la raconter à elle-même, c'est-à-dire à un public français. Cette plongée ne pouvait se faire qu'avec un seul guide : notre histoire commune.
Tout exilé doit s’adapter au pays d'accueil. Pour les hommes de théâtre, il ne s'agit pas de s'adapter à la vie du pays mais de se convertir, et cette conversion nécessaire va mettre en danger, non pas nos choix politiques et philosophiques, mais bien plus que ça. Elle met à l'épreuve notre capacité à accepter l’autre.
Écrire et faire du théâtre, c’est choisir les émotions justes sur lesquelles on articule des idées pour les rendre audibles. C’est cette alchimie qui entre en jeu, consciemment ou inconsciemment, dans tout processus de création. L’équilibre entre émotions et idées, entre le ludique et l’intellectuel, doit être maintenu. S’il est profondément perturbé, il devient alors déstabilisant et engendre une perte de confiance en soi et l’autre devient dangereux.
Un voyage initiatique est nécessaire pour se refaire et apprendre à accepter l’autre. Ceux qui osent le voyage deviendront féconds pour le pays d'accueil. Ceux qui n'osent pas ou refusent ce voyage nourrissent des ressentiments contre le pays d'accueil parce qu'ils le rendent responsable de les avoir mis devant des choix impossibles.
Quel a été mon voyage ?
Je me définis comme triculturel, de culture berbère, française et arabe. Ma langue est ma pluralité ; mon lieu culturel est mon métissage. Ma parole en est la synthèse. Ainsi, je suis le fils de l’histoire et non de mes parents. Ils ont été mes géniteurs biologiques et mon existence culturelle allait se faire ailleurs que dans l’espace d’origine.
L’histoire allait devenir une sorte de lieu psychanalytique dans lequel je forge ma pluralité. Aujourd’hui elle est la justification et la raison de mon outil : la langue. Elle est mon alibi identitaire. Celle du métis qui sait plusieurs langues et que chaque langue ignore.
Et c’est là où j’ai pris conscience que la liberté francophone n’est pas une essence, mais une conséquence. Parce qu’une fois qu’on a pris suffisamment le temps de tout détruire autour de vous, jusqu’au moindre balbutiement, quand ma mère a fini par parler le silence dialectal, la langue française devient un véritable espace de liberté et le lien réel et unique avec l’universel. Mais à partir d’où et pour dire quoi ? Et là, les questions se succèdent creusant un gouffre entre ce que je ressens vouloir dire et les outils que j’ai pour le dire.
Naissent alors en moi des blocages, des inhibitions, dues au fait que je prends conscience au fur et à mesure, que je possède une langue, une culture qui m’ont déplacé de mon espace d'origine sans m’inscrire tout à fait dans son espace. Nous sommes des banlieusards de la littérature. Parce que du côté français l'esprit de culture dominante persiste avec force. Voilà ce que dit M. Dominique Wolton dans une conférence faite sur le thème «Diversités culturelles et francophonies». Je cite :
«Je prendrai un exemple politique important : nous venons de vivre en France – et nous continuons de le vivre — un débat très important sur la question de la laïcité et sur le problème de savoir s'il faut ou non faire une loi concernant le voile, vu comme un symbole. On a longtemps perçu la laïcité française comme un modèle d'intégration. Nous l'avons vécue culturellement comme un moyen d'intégration mais avec une connotation de domination.
Autrement dit, depuis 1905, les gens s'intégraient au modèle de la laïcité, modèle républicain français, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ce qui change — et on le voit très bien dans les réactions en France et à l'étranger par rapport à l'hypothèse d'une loi — c'est que les autres sont beaucoup plus visibles qu'avant. Autrement dit, celui pour lequel on veut défendre les valeurs laïques ou que l'on veut intégrer dans un modèle républicain n'est plus d'accord. Parce que nous étions dans un modèle culturel de domination et que nous sommes maintenant dans un modèle culturel de coopération et qu'on ne peut pas imposer à d'autres communautés, en France et à l'étranger, au titre d'un certain ‘‘art démocratique’’ ou d'une certaine conception de la laïcité, un modèle qui ne lui correspond pas.
Et je suis frappé de constater, dans le débat sur la laïcité, que les meilleures intentions du monde se retournent contre ceux qui les invoquent, tout simplement parce que l'autre est présent chez nous, et en fait, traite la République française de néo-communautariste, ce qui est exactement l'inverse de ce que nous voulions faire.
Je vois dans ce symptôme, ce surgissement des hostilités radicales à une législation, le fait que ce qui a changé en un siècle, c’est que l’autre est présent et que l'altérité existe. Ce qu’il se passe pour la laïcité, je pense qu’il pourrait se passer pour la francophonie : une partie des peuples, des communautés francophones, pourrait un jour se retourner contre la France en disant : ‘‘Vous avez un rôle essentiel dans la francophonie, mais vous n'êtes plus propriétaire de la francophonie et vous n'êtes plus propriétaire de sa définition et des compétences culturelles.’’ Pour éviter cette espèce de boomerang que nous sommes en train de recevoir sur la laïcité, il nous faut ouvrir, le plus tôt possible, la francophonie à une bien plus grande diversité culturelle en son sein. De ce point de vue-là, comme travail pratique, il faudrait faire une liste des divergences qui existent au sein de cette francophonie, avec les enjeux culturels, politiques, idéologiques et historiques... Il faut aussi reprendre quelque chose qui me tient énormément à cœur, car je pense qu'on n'avancera pas dans la diversité culturelle au niveau mondial sans cela, ce sont les problématiques de la colonisation et de la décolonisation pour comprendre ce qui fait que les gens, malgré le fait qu'ils soient sensibles à la francophonie, sont d'accord ou pas sur telle ou telle chose.»
Cette domination culturelle qui persiste est aliénante, elle prend en otage notre imaginaire. Nous sommes considérés comme des utilisateurs de la langue et non des créateurs dans la langue. Le seul apport créatif dans la forme attendu de notre part, c’est introduire des arabismes ou des africanismes dans la langue et tout le monde crie au génie !
Et les critiques sur nous sont des jugements paternalistes, et les prix qu’on peut avoir sont des prix politico-littéraires, qui récompensent non pas notre talent d’écrivains mais plus notre talent à nous sentir francophones. Les gouvernements étant politiquement alliés de nos gouvernants, leur complicité fait qu’on n’existe plus là-bas et qu’on a l’illusion d’exister ici.
Nous finissons par être des hybrides qui ne correspondent à rien. Entre-temps, nous avons été évacués de notre réel terrain d’efficacité, c'est-à-dire nos sociétés, et nous avons servi à renforcer les politiques francophones. Si j’ose dire cela c’est parce que j’ai un sérieux problème avec la «solidarité francophone». Où se situe cette solidarité ? On est solidaire de quoi ? Et pour faire quoi ? Et qui est solidaire avec qui ?
Les raisons profondes de ce genre de situations sont très bien analysées par Mme Baida Chikhi dans un article «La francophonie aujourd’hui : réflexion critique».
«En somme, déclinée à tous les modes, à tous les genres, comme la ‘‘fée Clochette’’, la francophonie est soumise au paraître/disparaître et à l'humeur d'un agitateur masqué ; son apparence et son intérêt varient selon le point de vue à faire valoir. Mais reconnaissons que c'est en France que la francophonie semble poser problème.
La même question revient, à peine voilée, comme une litanie : que faire de tout ça ? De tous ces textes écrits en français ? De ces écrivains qui viennent d'ailleurs et se font publier ici, raflent les prix littéraires, envahissent les librairies et les salons littéraires ? Comment les nommer ? Où les placer ? Comment les classer ?»
Par ailleurs, l’occultation de l’histoire est aussi chose aliénante et jusqu’où peut-on occulter l’histoire. Si la langue française porte la culture française, elle porte aussi notre histoire commune et ceci d’une manière indélébile, sinon je ne m’explique pas comment je suis devenu francophone. La seule manière de retrouver ma liberté totale, c’est de liquider ce contentieux, c’est de nous libérer des vicissitudes de l’histoire car c’est à partir de cette histoire commune que je raconte mes histoires.
C’est grâce à cette histoire commune qu'à chaque étape, j'ai essayé de retrouver une place dans cette société et cette place n'était autre qu'une interrogation nouvelle sur ma propre histoire. La seule manière d’y répondre a été de convoquer l'histoire au théâtre et de l'interroger publiquement. Car il s'agit avant toute chose de savoir de quelle histoire relève notre malheur. Et si le théâtre, c'est danser sur le malheur, avant de danser, il faut nommer ce malheur. Et à ce moment, j’ai l’impression de ne pas être compris par les Français. Cette incompréhension par les Français constitue déjà la première barrière à l’universalité. On n’a pas le «label rouge» Quand je suis arrivé en France, la première pièce que j’ai voulu monter était Le conseil de discipline.
Ce que raconte la pièce :
«Fin mai 1959, dans un collège de l’Est algérien. Au cours d’une dispute, Jacomino a blessé Atmourt d'un coup de couteau. Un conseil de discipline est décidé. Vu la situation politique et les tensions qui règnent un peu partout, tant dans la ville qu'au collège, le proviseur craint que ce conseil de discipline ne dégénère en bataille rangée. Afin de prévenir les affrontements, il organise une rencontre, qu'il voudrait conviviale, et y invite six professeurs, représentatifs des différentes tendances, pour tenir une sorte de ‘’pré-conseil’’. Sultanat, Sisco, Mauzer, Tahar, Billard, Cohen et le proviseur se retrouvent donc dans une clairière, aux alentours de la ville, pour un étrange pique-nique.»
Cette pièce, parce qu’elle traite de la guerre de libération et malgré le soutien du Festival des francophonies de Limoges, plus de vingt metteurs en scène n’ont pas voulu y toucher, et c’est en Belgique qu’elle fut réalisée.
Quand je parle de ma société dans l’espace de la langue française, il y a globalement deux attitudes :
- La première, je considère que les deux espaces sont isomorphes, qu’ils ont les mêmes limites, les mêmes libertés, la même densité. A ce moment toute critique de ma société est accablante et toute générosité à son égard est ridicule. Parce que mon regard est extérieur à ma société ou plutôt son point de départ n'est pas dans le centre de ce qui fait l'objet de mon discours. Je ne suis pas dans l’œil de mon cyclone. Mais j’aurais parlé de moi dans les codes de la langue française pour un lectorat français. Pour plusieurs raisons, les Algériens n’y ont pas accès du tout, d’autant plus qu’elle ne leur parle pas. La littérature africaine existe comme elle peut en France, mais en Afrique, on ne sait pas ce qui se crée, puis s’édite à Paris.
Ainsi, nous écrivons des livres où nous parlons d’une société qui ne nous lit pas et ils sont vendus dans une société qui à la limite s’en fout. Quelle est notre utilité ? Je me le demande.
- La seconde attitude est de tenter de rester soi, dans les limites de notre société, et prendre dans la langue française juste les mots pour dire sans se référer à elle ; à ce moment, on est auteur mineur pour la langue française.
Comment être totalement moi dans une langue qui n'est pas totalement moi ? Comment prendre l’envol nécessaire ?
La langue française est magicienne, elle me séduit, elle est ciselée depuis des siècles par des talents, elle vous happe, vous imbibe, on a beau se défendre on finit par céder à l’ivresse de sa beauté, tout en étant malheureux d’être sur la défensive. On s'égare longtemps pour dire un mot qui puisse ressembler à une parole, qui serait le début d’une écriture. Qu’est-ce qu’être auteur si ce n’est faire vivre autrement la langue que j’utilise et la poursuivre jusqu’à lui faire dire ce qu’elle n’a jamais dit autant dans la forme que dans le contenu ? Comme dit Mme Barbara Cassin : «Une langue, c’est des auteurs et des œuvres, c’est-à-dire une vision du monde.» Dans ces conditions, je n’ai pas une vision du monde, je suis bloqué à une vision des langues.
La langue française me séduit à me faire dire que ma mère n’est rien, parce que la référence du tout est ailleurs. Est-ce que ma mère est rien ? Pardonnez-moi mais je ne le crois pas… Ma mère peut être le rien de beaucoup de «tout», je n’en disconvins pas et je ne le nie pas. Ce qui m’intéresse, ce qui me pousse à écrire, c'est la recherche de son tout à elle. Seul idéal psychanalytique que je connaisse sans lequel toute écriture est vaine.
Écrire, c’est se réfléchir, c’est se projeter dans l'imaginaire avec comme seule certitude notre naissance et avec comme espoir toujours une renaissance pour un monde meilleur. Comment renaître dans le doute de sa naissance ? En tant que francophone, je me considère enfant adoptif qui, à un moment, doit trouver réponse à sa naissance. En conclusion, la francophonie est comme toutes les politiques, elle ne tient pas ses promesses. Et d’abord qu’est-ce qu’elle nous a promis ? A vrai dire, rien ! Donc c’est une politique qui ne promet rien. La liberté et aliénation francophonique relève d’un paradoxe, la langue française nous donne une distance par rapport à notre société et c’est là que s’inscrit la liberté. Mais cette distance est trop grande, elle modifie fatalement notre regard sur nous-mêmes, et ça c’est aliénant. Sur le plan culturel, elle est une grande ouverture ; sur le plan de notre relation historique, elle demeurera dans notre imaginaire, la blessure par laquelle nous sommes contraints de dire toutes nos autres blessures. La difficile coexistence des langues durera tant qu’on n’aura pas résolu notre problème avec l’histoire et qu’on «trimbalera» nos diverses langues comme des tares et comme les pires de nos ennemis. Pour moi, c’est grand dommage et en tant qu’écrivain, c’est une vraie douleur. Mis sur le banc de deux sociétés, celle du départ et celle de l’arrivée, on devient un regard libre. Notre projection dans le temps se mesure en unités d’existence et non d’appartenance. Nous sommes obligés de nous dépecer de nos douleurs pour pouvoir encore lire le malheur qui nous entoure. Je troque ainsi mes douleurs d’homme contre des joies d’artiste. Nul n’est exempt du malheur, et rares sont les artistes heureux.
S. B.
(*) Dramaturge
Contribution d’Abdellali Merdaci – Brève adresse à un naturalisé honteux
Par Abdellali Merdaci (*)
Slimane Benaïssa. D. R.
Vous nous avez quittés, muni d’un titre de passage de frontières et de long séjour de l’ambassade de France à Alger. Une résidence d’écriture en province. Et, certes, à cette époque, vous n’étiez pas le seul. C’était en 1993, un terrible millésime. La France accueillait et protégeait sereinement les tueurs islamistes et, aussi, leurs probables victimes. Vous en étiez donc, Slimane Benaïssa, ni tueur ni victime, mais fieffé chasseur d’aubaine. Les raisons de votre migration vers le nord étaient, pour vous, claires et celles de votre retour dans ce qui était votre pays ne devaient pas, pour nous, l’être moins. Ne cherchez pas le refuge d’un faux débat sur l’altérité ; c’était une séparation. Car le mot «exil» n’existe pas dans votre maigre glossaire. Vous êtes resté en France et vous vous êtes fait naturaliser français : vous avez «réintégré» ce qui vous fut une mère-patrie d’antan et ses douces commodités, celle que vous chérissez plus que votre «mère biologique». Mais, contrairement à beaucoup de vos comparses qui proclament leur totale francité, à l’image d’un Anouar Benmalek, vous êtes un Français honteux. Vous vous cachez, craignant le vif opprobre.
Comme vous ne serez jamais reçu dans un journal français pour semer vos sombres et tardives billevesées, vous les étalez sur trois pages dans un quotidien algérien. Sans doute, dans un pays de jeunes, les lecteurs de ce titre qui ont plus de cinquante ans vous connaissent un peu, qui se remémorent le comédien, votre profession principale. A aucun moment de votre infinie et ridicule logorrhée philosophico-analytique sur un incernable Autre, vous ne leur concédez l’essentiel, ce qui est nécessaire à la compréhension de votre ruineuse et nauséeuse tirade. C’est à partir de votre position de «mtourèze» que vous construisez un inquiétant argumentaire de survie après un quart de siècle accompli dans la nationalité de l’ancien colonisateur, celle que le peuple algérien a expurgée par une sanglante guerre d’indépendance (1954-1962) et par son vote unanime, le 1er juillet 1962, pour une patrie retrouvée. Vous pouvez cracher sur cette Histoire qui n’est plus la vôtre : vous avez été retourné, revêtu des oripeaux du «m’torni» de sinistre mémoire, dans une accablante version néo-indigène.
Né sujet français, élevé à la citoyenneté française dans une vaine politique coloniale de la vingt-cinquième heure, Algérien par filiation à l’indépendance, vous êtes donc «retourné» à la France, ce qui est votre droit. Et vous n’en ignorez pas le protocole aisé, indiscutable : Français par «choix individuel». Comme l’exigeaient les sénatus-consultes (1863-1865) de l’Empire et, désormais, les lois de la République française. Mais, de grâce, foutez-nous la paix. Trois pages de «chiens écrasés» valent mieux que vos aveux. Les Algériens ne vous demandent rien, alors que vous en attendez tout. Vous êtes encore là, à l’affût pour grappiller, toute honte bue, des rôles dans le cinéma algérien et aussi, pourquoi pas, des hommages publics nationaux, comme votre compatriote naturalisé Merzak Allouache, ami du sionisme international, gratifié au printemps 2017 par l’Etat algérien de la médaille du Mérite national, qui, comme vous, n’a plus depuis longtemps aucune attache avec le pays et la nation. Probablement, une erreur de casting, mais elle ne vous empêche pas d’y croire, malgré que vous ayez depuis si longtemps coupé et piétiné le lien national.
Comme Anouar Benmalek – décidément ! –, vous n’hésitez pas à prendre ce qu’il y a encore à prendre dans un pays que vous avez en toute conscience abandonné lorsqu’il tombait en quenouille sous les coups de boutoir de l’islamisme armé, l’enlevant voracement de la bouche de ses enfants méritants. Pour vous et pour vos semblables, ce n’est jamais assez. Où est l’éthique ?
En 1993, vous vouliez vivre parce que Tahar Djaout, Abdelkader Alloula, Youcef Sebti, Salah Fellah, Azzedine Medjoubi, mais aussi des dizaines de milliers d’Algériens sont tombés sous les balles assassines de l’AIS, des GIA et des «katibate» de toutes obédiences barbares. Vous ne vouliez pas résister, mais prendre le large, réintégrant – c’est, en effet, le terme juridique idoine – la nationalité française au moment où des Algériens mouraient. Laissez-moi vous parler de mes amis du Théâtre régional de Constantine, listés sur de funèbres affiches accolées dans les mosquées du Bardo et d’Aouinet El-Foul, condamnés à mort par d’inattendus tribunaux de la foi, leur sang licité, guettés aux aubes muettes. Ils n’étaient pas, en ces années 1990 comme aujourd’hui, moins grands que vous prétendez l’être. Ils gardèrent les murs de leur théâtre, montant sur scène à l’heure antique de tous les sacrifices. Ils résistèrent, cousant chaque jour une taie d’espoir. Et avec eux, sur tous les tréteaux de fortune du pays, les corps noirs de comédiennes et de comédiens hallucinés, accrochés à des lendemains sans sang et sans deuils : leur théâtre ne s’est pas tari. Ils jouaient à tromper la mort ; c’était-là leur honneur inaliénable. Et, à leur image, de centaines de milliers d’Algériens anonymes présents à leurs postes de travail pour maintenir, vaille que vaille, leur pays debout, malgré les écoles détruites, les routes assiégées, les usines saccagées, les terres calcinées. Ils n’ont pas abdiqué devant la violence islamiste. Vous avez déserté, face à la mort et au malheur, pour sauver votre peau et profiter d’une impénétrable ligne de crédit de l’obscure diplomatie française. Lorsqu’on a traversé la mer non pas pour le respectable exil qui a formé les Grands Esprits, la décence aurait été de ne point en rajouter, simplement de vous taire.
Et voilà que vous nous revenez, sans un mot de remords, sans contrition, en criant sur les toits. Comme si vous étiez toujours de cette famille de Veilleurs d’espérances, que vous avez répudiée pour aimer et apprendre à aimer, vous le scandez dans votre confession, une Autre. Alors, vous vous emparez de la posture du maître pour nous enseigner le vain couplet des Pleureuses de l’ancien temps, qui ne reviendra pas. Vous vous complaisez à suriner cette complainte du néocolonisé miséreux, s’agenouillant devant la sacro-sainte France et sa langue. Vous nous bassinez ce couplet, maintes fois entendu depuis Senghor pour devenir rébarbatif, de la langue française dispensatrice de liberté. Vous secouez cette fumeuse potion d’une «pluralité» et d’un «métissage» circonstanciés, pour en fin de course vous découvrir français. Car cette «pluralité» et ce «métissage», lourdement invoqués, ne sont que le déni de la nationalité algérienne originelle qu’il vous faut noyer dans le putrescent alambic de certitudes avariées.
La France a fait de vous un «métis», subjugué par sa langue. Vous ne le seriez pas si vous étiez resté en Algérie pour revivifier votre habituel répertoire de théâtre en arabe dialectal et vous n’auriez pas été requis d’apporter de bruyants gages de fidélité et d’assimilation réussie par la langue au pays qui vous a enrôlé dans ses empressées harkas, aussi amorales que le furent celles de la guerre anticoloniale, tirant dans le dos des Innocents.
Mais voilà que vous vous interrogiez, après avoir égrené à longueur de colonnes du Soir d’Algérie vos indigestes palinodies d’Arabe français, sur la destinée des écrivains qui vous ressemblent. Vous vous alarmez de tous ces écrivains d’ailleurs édités en France et squattant ses librairies et ses salons littéraires : «Comment les nommer ? Où les placer ? Comment les classer ?» En ce qui vous concerne, vous ne cultivez pas le doute. Vous vous situez à la suite d’«une génération d’écrivains qui nous ont précédés, celle de Kateb Yacine, Mohammed Dib, Malek Haddad, Mouloud Feraoun». Or, cela est vérifiable : aucun de ces écrivains n’a opté pour la nationalité française après l’indépendance, comme c’est le cas pour vous. Vous avez choisi d’être français, vous ne pouvez plus revendiquer, et c’est valable pour ceux qui ont suivi le même chemin que vous, une appartenance à la littérature algérienne qui n’est ni un bordel en rase campagne ni un miteux hôtel pour demi-soldes de la France littéraire.
Entendons-nous : ne sont dignes de la littérature algérienne et de la nationalité littéraire algérienne que ceux et celles qui portent l’histoire passée, présente et à venir de leur nation, dont vous vous êtes volontairement exclu, par «choix individuel», il convient de le répéter. Français, vous devez vous battre pour vous faire reconnaître dans la littérature française, la littérature de votre pays, car c’est une vérité universelle que la littérature affleure dans le corpus national d’un Etat libre et indépendant, avant d’atteindre l’universalité. Shakespeare, c’est l’Angleterre, Cervantès, l’Espagne, Goethe, l’Allemagne, Voltaire, la France, Dante, l’Italie, Tolstoï, la Russie. Ne prétendez pas incarner la littérature des Algériens ; ils ne vous ont pas sollicité pour être leur interprète auprès de la France dont ils n’ont cure. Vous devez vous convaincre que le «vécu algérien» vous échappe, parce que vous êtes un Français, de Paris ou de Nogent-le-Rotrou, peu importe.
Pourtant, il vous arrive d’être lucide. Pour diverses raisons, vous n’excluez pas la possibilité de n’être qu’un «auteur mineur» et de produire une littérature désemparée, sans lecteurs et sans perspectives, incompris dans votre pays d’adoption. En un quart de siècle de nationalité française, vous n’avez pas changé le visage de la France. En retour, vous avez outrageusement zingué le vôtre à l’horizon de cruelles illusions. Cela est si vrai que la France littéraire vous néglige, nonobstant vos «In» à Avignon. Vous ne serez jamais élu à ses grands prix littéraires ni coopté dans ses académies, ni comme Alain Mabamckou, autre «zingueur de face» à votre façon, invité dans sa plus prestigieuse institution universitaire pour exhaler le sanglot de l’Arabe peinturluré de vernis de civilisation française.
Si la France ne vous attend pas et ne vous a pas attendu, l’Algérie vous a oublié. Votre drame, vous le résumez parfaitement : vous êtes «le fils d’une histoire», assurément française, qui ne vous a rien donné. Il aurait mieux valu pour vous rester celui de vos parents biologiques. Algérien et Français, éveillant en vous la défunte Algérie française, vous vous autorisez l’imparable prophétie. Vous prédisiez, au tournant des années 2000-2010, que l’idée de nation algérienne s’effilochait en raison de ceux qui vous ont imité, trop nombreux à votre gré : «Si l’Algérie continue comme ça, elle deviendra française par choix individuels.» (Cf. Séverine Labat, La France réinventée. Les nouveaux binationaux franco-algériens, Paris, Publisud, 2010, p.173). Aujourd’hui comme hier, le pays ne s’est pas vidé de sa population et les fondations de la nation algérienne restent inébranlables. Dix ans après, l’Algérie n’est pas devenue française ; elle s’est, salutairement, débarrassée de ses dernières légions de soldats perdus, semblables à ceux de l’An VII de la Révolution, jetés dans les décombres fumantes de la trahison et l’ignominie.
Ce qui transparaît, de manière évidente, dans votre monologue de «métis», obstinément théâtreux, cherchant éperdument les ultimes feux de la rampe, c’est l’insurmontable fêlure d’une identité algérienne niée, torturant de ténèbres votre parcours de Français dissimulé. Ni votre philosophe de café du commerce ni votre «psychanalyse pour les nuls» n’endigueront le désarroi d’un quart de siècle de reniement.
A. M.
(*) Professeur de l’enseignement supérieur. Écrivain et critique