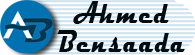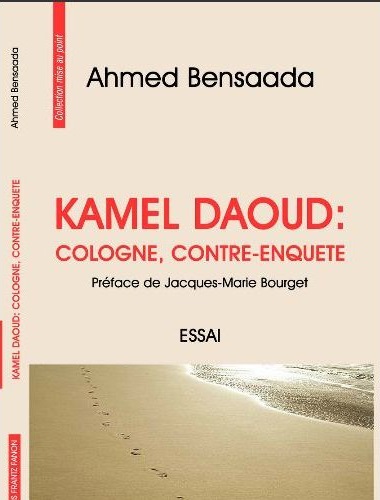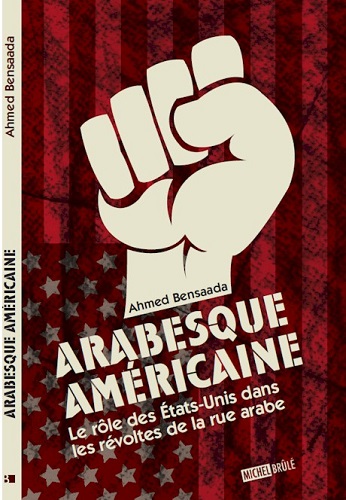Dossier Kamel Daoud - Al Akhbar
Journal Al Akhbar (Liban), édition du samedi 3 mars 2018
Version française
Liste des articles
Lina Kennouche: "La forfaiture du chroniqueur, un préalable à la consécration du romancier "
Ahmed Bensaada: "Sur Kamel Daoud, informateur indigène " (Entretien: Lina Kennouche)
Karim Kia: "De Cologne à Sétif : les approximations dangereuses d’une plume impatiente "
Mohamed Bouhamidi: "Kamel Daoud ou les métamorphoses du même au même"
La forfaiture du chroniqueur, un préalable à la consécration du romancier
Par Lina Kennouche

Dans une tribune le 7 septembre 2017 publié sur Le Point « La fabrication du traître. Les islamistes réinventent le dictionnaire. L'intellectuel soucieux de liberté doit briser ce monopole sur les mots pour se faire entendre », l’écrivain algérien francophone, Kamel Daoud se revendique comme « traitre » dans une acception sartrienne de l’intellectuel « traitre » à sa classe d’origine. Intervenant dans le débat sur la sexualité au Maroc, il écrit qu’ « il ne s’agit pas en effet de la seule question de l’interdit du corps et du désir, mais de tout le statut des intellectuels opposants aux ordres conservateurs politiques ou religieux. Par une sourde ruse de rhétorique maligne, le discours conservateur dans nos pays a réussi le tour de force d’exclure des concepts du champ éditorial quotidien pour les confondre avec l’Autre, c’est à dire l’Occident et donc disqualifier les porteurs de discours critiques et les réformateurs ». C’est au nom de l’exercice de la pensée critique et de l’impérieuse exigence d’autocritique que Kamel Daoud tente de légitimer ses prises de positions incongrues. Se présentant comme un ardent promoteur des valeurs libertaires et humanistes, le chroniqueur se pose en éclaireur de la conscience occidentale dans le contexte de la guerre contre Gaza en juillet 2014.
Dans un frémissement éditorial, il publie le 12 juillet dans le quotidien d’Oran une chronique (« ce pourquoi je ne suis pas solidaire avec la Palestine ») déroutante à plusieurs égards. Daoud y dénonce l’indignation sélective des opinions publiques arabes et épilogue sur les raisons de sa dissidence sur le terrain de « cette solidarité au nom de l’Islam et de la haine du juif ou de l’autre ». « Cette « solidarité » facile fermerait les yeux sur le Hamas et sa nature, sur les divisions palestiniennes, sur leurs incapacités et leurs faiblesses au nom du respect aux « combattants » écrit-il. Comble de l’ignominie, en plein massacre, le doxosophe reprend à son compte le mythe de la démocratie israélienne « Comment peut-on se permettre la vanité de la « solidarité » alors qu’on n’est pas capable de joueur le jeu des démocraties : avoir des élus juifs « chez nous », comme il y a des élus arabes « chez eux » s’interroge-t-il. Celui que l’on qualifie de « transgressif » a été jusqu’à reproduire dans la presse algérienne le discours de la droite israélienne, en s'inscrivant en faux avec les représentations de sa propre société sur une cause centrale des nations arabes qui condense tous les enjeux de la lutte contre le colonialisme et des rapports Nord/Sud.
Inscrit idéologiquement dans la tradition coloniale et islamophobe de l’Occident, cet auteur à la plume supplétive n’a rien de traitre à une classe au sens sartrien, qui définit l’intellectuel révolutionnaire comme celui qui s’émancipe de la classe bourgeoise dont il est issue pour défendre les classes populaires. Kamel Daoud est traitre tout court, il est l’incarnation caricaturale du faux-intellectuel dissident qui rallie les rangs des puissances dominantes : il trahit les sociétés dominées du sud au profit de l’Occident, il trahit les faibles pour servir les plus forts. C’est sur cette forfaiture du chroniqueur érigeant ses vulgaires clichés orientalistes en vérités apodictiques indiscutables que repose la consécration de l’écrivain en quête de reconnaissance.
Cette idée du chroniqueur qui porte le succès l'écrivain a été mise en exergue par l’universitaire algérien Abdellali Merdaci dans ses différentes chroniques. A travers sa littérature creuse de « l’émancipation » (des pesanteurs des sociétés archaïques), l’écrivain ne fait en effet que reproduire, dans une version esthétisante et édulcorée, les préjugés racistes et les lieux communs machés et rebachés à longueur de chroniques. Comme l’a magistralement relevé l’auteur Djawad Rostom Touati dans sa critique de Zabor, les œuvres de KD sont une montée en puissance dans la névrose et la haine de soi, véhiculant un nécolonialisme implacable derrière le rideau littéraire. L’obsédante représentation d’un islam fanatique, l’antagonisme irréductible entre l’Occidental paré de toutes les vertus et l’Arabe affublé de toutes les tares restent une constante dans ses œuvres. Sans le moindre génie inventif dans le cliché, Daoud insuffle son souffle romanesque pour y décrire des peuples arriérés dotés d’instincts primaires, ces mêmes Arabes et musulmans qu’il désigne par une référence collective et dépersonnalisante dans la presse. La production littéraire de l’écrivain n’est que le miroir symptomatique de son « esprit colonisé » expliqué par l’essayiste Ahmed Bensaada, porté par l’« amour du colonisateur» et une «haine de soi » qui le poussent à épouser « automatiquement les idées les plus réactionnaires de l’ex-colonisateur» et se métamorphoser « à l’image du colonisateur dans le but ultime d’être finalement accepté par son modèle». Nostalgie maladive du colonialisme, mystification du rôle de la langue et la culture française, rejet véhément de toute caractérisation à l’arabité et à l’islam, Kamel Daoud, fait figure de l’intellectuel supplétif qui s’exprime à la place du maître à penser et c’est à la faveur de ce rôle d’agent de diffusion à la solde de l’hégémonie culturelle occidentale que s’affirme le succès littéraire de l’écrivain. Comme le rappelle dans sa chronique Mohamed Bouhamidi, l’écriture de Kamel Daoud est « une écriture au service d’une thèse, non d’une quête de la compréhension d’une Algérie qui change, qui bouge, comme dans les œuvres de Mouloud Mammeri ou de Mohamed Dib, d’une Algérie qui cherche ses pères et sa femme magique. Au service d’une thèse, elle est en sus une écriture mercenaire, une écriture à la commande, comme ce Meursault, le premier livre dans l’histoire de la littérature à avoir une version pour indigène et une version pour la métropole ».
Ces 15 dernières années, tandis que le monde arabe était le « théâtre central des opérations militaires » américaines, et que les Etats-Unis et leurs alliés, au nom de la lutte contre le terrorisme, ont normalisé l’islamophobie comme discours de guerre, allant jusqu'à renouer avec les thèses les plus éculées du colonialisme, Kamel Daoud et ses coreligionnaires ont apporté une caution « autochtone » au discours impérial. C’est précisément dans ce contexte d’interventions étrangères, de déstabilisation des Etats et de déstructuration des sociétés que les pseudo-intellectuel imputent l’origine des blocages économiques et politiques à des facteurs exclusivement internes. Enfourchant dans un mouvement de moutonnie la cause de l’universalisme occidental, Daoud n’a cessé de distiller sa haine du monde arabe et musulman, de dénoncer le pourrissement des consciences dans ces contrées malades en servant ad nauseam les présupposés justificateurs de l’incompatibilité fondamentale de « sa » culture avec les valeurs de la modernité politique. Sans le moindre examen critique de la pratique occidentale en matière de liberté et de droits de l’homme dans la gestion des affaires du monde arabe, Daoud a exprimé sa dévotion à la « suprématie » culturelle occidentale. Sa vision essentialiste considère que les structures anthropologiques dans le monde arabe sont à l’origine de l’échec de la modernité politique. L’écrivain est l’antithèse de l’ « intellectuel soucieux de liberté », producteur de sens et de savoir, qui se doit de comprendre et d'expliquer sa société, ce par quoi elle est travaillée et ce à quoi elle aspire. Avide de reconnaissance, il est au contraire l’anti-intellectuel par excellence, dans l’acception qu’Antonio Gramsci ou Jean Paul Sartre donnait à l’intellectuel.
Ahmed Bensaada:
Sur Kamel Daoud, "informateur indigène"
Interview de Lina Kennouche

Ahmed Bensaada est l'auteur de l’essai : « Kamel Daoud : Cologne, contre-enquête » (Alger, éditions Frantz Fanon, juin 2016 ; préface de Jacques-Marie Bourget)
1/En reprenant la grille de lecture d’Albert Memmi vous décrivez Kamel Daoud comme un écrivain « néocolonisé » qui remplit une fonction « d’informateur indigène » apportant une caution « ethnique » aux idéologues de la théorie du choc des civilisations. Quelles sont les caractéristiques de l’esprit néocolonisé ?
Dans sa précise description du colonisé, Albert Memmi a mis l’accent sur sa déshumanisation, la mystification de ses supposées tares, sa catalepsie sociale et historique, son amnésie culturelle et son éviction de l’Histoire. Le colonisé cultive la haine de soi et la honte de ses racines. Il porte aux nues le colonisateur et œuvre inlassablement pour lui ressembler. À ce sujet, Memmi note que « l'ambition première du colonisé sera d'égaler ce modèle prestigieux, de lui ressembler jusqu'à disparaître en lui ». Ou encore : « L'amour du colonisateur est sous-tendu d'un complexe de sentiments qui vont de la honte à la haine de soi. »
Le colonisé a également un rapport maladif avec sa langue maternelle. Il la méprise et glorifie celle du colonisateur.
Selon Memmi, le colonisé est hors du temps et de l’histoire : « Plus rien ne s’est passé dans la vie de ce peuple. Rien de particulier à son existence propre, qui mérite d'être retenu par la conscience collective, et fêté. Rien qu'un grand vide ». De ce fait, il a honte de ses référents culturels qu’il va systématiquement renier et rejeter. Finalement, il va mimétiser le colonisateur afin d’avoir la satisfaction ultime : être accepté par son modèle.
2/Vous considérez que l’écrivain a atteint le stade ultime du processus de mimétisation qui l’amène à reproduire fidèlement le discours et l’attitude du colonisateur. Comment s'est traduite cette évolution à travers ses écrits ?
Kamel Daoud s’est fait connaitre par ses chroniques dans le Quotidien d’Oran. Sa grande popularité vient du fait qu’il critiquait ouvertement le gouvernement et les travers de la société algérienne.
Cependant, ses écrits ont progressivement glissé de la critique constructive à l’injure de sa communauté, de l’impertinence intellectuelle à la vulgarité de l’insulte.
Après sa nostalgie de la colonisation avec une déclaration du style « la terre appartient à ceux qui la respectent. Si nous, les Algériens, en sommes incapables alors autant la rendre aux colons », son aversion envers la langue arabe qu’il considère morte ou «langue de colonisation », le paroxysme est atteint avec l’affaire des viols de Cologne. Sans même attendre les résultats de l’enquête (qui ont révélé que cette affaire était un pur canular), notre chroniqueur a traité les réfugiés arabes de « violeurs en puissance ». Et d’asséner sa vérité, celle destinée aux lecteurs du monde des lumières, du monde civilisé : « Le grand public en Occident découvre, dans la peur et l’agitation, que dans le monde musulman le sexe est malade et que cette maladie est en train de gagner ses propres terres ».
Avec les résultats de l’enquête à Cologne et le raz-de-marais médiatique provoqué dans le monde occidental (si idéalisé par le chroniqueur) par l’affaire Harvey Weinstein, Kamel Daoud se retrouve le bec dans l’eau et, conséquemment, exhibe sa nudité intellectuelle.
3/Vous citez le propos de Kamel Daoud expliquant son rapport à la langue arabe. A l’exact opposé de Kateb Yacine qui considérait le français comme un « butin de guerre », Daoud lui entretient un rapport pacifié à une langue qu’il considère comme un « bien vacant » et un rapport conflictuel avec la langue arabe perçue comme langue de colonisation. Quelle est la signification profonde de ce rejet linguistique ?
Kamel Daoud cherche toujours à faire du neuf avec du vieux, surtout si le vieux est majestueux. Par ici, il picore du Camus, par là il grappille du Defoe et, entre deux becquetées, il grignote du Kateb Yacine.
Concernant la langue française, les deux expressions se réfèrent à la guerre d’indépendance algérienne. Mais une nuance de taille les sépare : la première considère que l’usage de la langue française a été gagné par une victoire militaire, alors que la seconde juge que cette langue a été abandonnée en Algérie par les colons après la révolution. Kateb Yacine a gagné cette langue par les armes alors que Kamel Daoud se l’est appropriée « ni par la violence ni par la guerre ». Pour le premier, il s’agit d’une langue de libération du joug colonial alors que pour le second, le français est la langue de la liberté intellectuelle, abandonnée par les colons en Algérie. Pour confirmer sa vision nostalgique de la période coloniale, il affirme qu’il a « un rapport pacifié au français ».
Pour Daoud, la langue arabe est par contre une langue morte « piégée par le sacré, par les idéologies dominantes », une langue « fétichisée, politisée et idéologisée ». Il admet que la langue arabe est une langue de colonisation allant même jusqu’à écrire qu’il s’agit « d’une colonisation réussie ». Et la langue française est-elle une langue de colonisation ? Bien sûr que non ! Oubliés les 132 ans de colonisation, de déculturation et d’acculturation méthodiques. Comme l’a si bien dit Hassan Gherab : « Là où la France passait, la culture trépassait ».
Pour Daoud, la langue du colonisateur est la langue du progrès, du développement, de la prospérité et de la lumière.
Ce rapport maladif à la langue arabe dont semble souffrir Kamel Daoud est très bien décrit par Albert Memmi qui a su, il y a de cela plusieurs décennies, si bien le cerner : « Dans le conflit linguistique qui habite le colonisé, sa langue maternelle est l'humiliée, l'écrasée. Et ce mépris, objectivement fondé, il finit par le faire sien. De lui-même, il se met à écarter cette langue infirme, à la cacher aux yeux des étrangers, à ne paraître à l'aise que dans la langue du colonisateur. »
4/ Vous expliquez que le « refus de solidarité » de Daoud avec la Palestine n’est pas lié à des convictions intellectuelles ou la moraline qui rejette la centralité de la cause palestinienne au nom d’autres combats. Comment analysez-vous, en ce cas, une position aussi controversée ?
Le rejet des référents culturels et idéologiques de sa communauté est bien illustré par cet exemple. Dans le monde, le peuple algérien est probablement celui qui a le plus d’amour et de respect pour le peuple palestinien. Sa cause est considérée comme une cause nationale algérienne et sa souffrance est vécue dans la chair de chaque Algérien.
Et voilà que notre chroniqueur écrit « qu’il n’est pas solidaire avec la Palestine » alors que les bombes pleuvent sur Gaza en 2014 et que des milliers d’enfants et d’adultes sont massacrés par l’État hébreux. Un carnage qui a même été dénoncé par des militants progressistes de confession juive !
Pire, il va jusqu’à encenser la démocratie israélienne (sic !) : « Comment peut-on se permettre la vanité de la « solidarité » alors qu’on n’est pas capable de jouer le jeu des démocraties : avoir des élus juifs "chez nous", comme il y a des élus arabes "chez eux" ».
Mais ce rejet n’est pas seulement idéologique, il est aussi intéressé. En effet, ces différents messages s’adressent particulièrement au lobby sioniste français, sans lequel il est difficile de prétendre à une brillante carrière dans l’Hexagone et dans cet Occident « daoudien » si lumineux.
D’un autre côté, chaque fois que l’auteur oranais est pris dans une tourmente médiatique, les premiers à monter au créneau pour le défendre sont des membres ou des affidés de ce lobby.
5/Dans le chapitre sur les « fatwas », vous rappelez le parallèle que dresse Mohammed Yefsah et Djamel Zerrouk entre Daoud et le Salafiste Hamadache, quel est le dénominateur commun entre les deux ?
D’après Mohammed Yefsah, « Hamadache et Daoud ont un point en commun : des haines et des frustrations, la matrice idéologique de la droite fascisante, mais chacun a sa sémantique. Ils sont des professionnels de la lapidation avec des mots ». Djamel Zerrouk, quant à lui, renvoie dos à dos les deux protagonistes de l’affaire en citant un internaute qui pense que « l’un voudrait être auréolé du titre d’un Salman Rushdie algérien et l’autre de chef d’une antenne algérienne de Daech ».
Certes, je suis contre toute espèce de fatwa provenant d’illuminés qui ont pris la religion en otage, mais il ne faut pas passer sous silence les « fatwas journalistiques » dont le chroniqueur est devenu un expert et qui lui ont valu la célébrité. Ces fatwas avec lesquelles il dégrade ses concitoyens et les rabaisse au niveau de bêtes ou de « tubes digestifs ». Ces fatwas avec lesquelles il discrédite leur foi et leur culture, et leur colle tous les maux de la Terre jusqu’à les traiter de violeurs par essence ou de se demander « En quoi les musulmans sont-ils utiles à l’humanité ? ».
Les deux sont donc des experts de la « fatwa », chacun dans son domaine. D’autant plus que Daoud en connait un rayon sur le sujet. N’a-t-il pas été, entre 1983 et 1990, imam islamiste de son lycée ? Ce qui fait dire au professeur Abdellali Merdaci : « l’écrivain-chroniqueur et l’imam constituent dans leur singulier face-à-face l’envers et l’avers d’une même histoire tragique ».
6/Dans le camp des défenseurs de Kamel Daoud, vous recensez notamment Manuel Valls, Elisabeth Lévy, Michel Onfray, Alain Finkielkraut, BHL qui ont tous en commun leur engagement sioniste et un puissant attachement à l’Etat d’Israël. En quoi Kamel Daoud intéresse-t-il ce milieu ?
En effet, toutes ces personnes font partie de la « ligue de défense » de Kamel Daoud. Ils se dressent comme une seule personne lorsque leur « protégé » est malmené à cause de ses écrits désobligeants envers sa communauté ou lorsqu’une fatwa est lancée contre lui.
Alain Gresh utilise une terminologie particulière qui explique pourquoi certains auteurs orientaux - comme Kamel Daoud - intéressent cette « ligue » occidentale.
Pour lui, il s’agit d’un « informateur indigène », « quelqu’un qui, simplement parce qu’il est noir ou musulman, est perçu comme un expert sur les Noirs ou sur les musulmans». Selon cette définition, Kamel Daoud est un « musulman qu’on aime bien en Occident ». Il s’agit d’un « "bon musulman", celui qui dit ce que nous avons envie d’entendre, et qui peut même aller plus loin encore dans la critique, car il ne saurait être soupçonné, lui qui est musulman, d’islamophobie ».
Pour Thomas Serres, Kamel Daoud sert d’« alibi ethnique qui vient à l’appui des discours culturalistes, racistes ou islamophobes ».
En écologie, une telle relation entre deux espèces est baptisée « mutualisme ». Il s’agit d’une interaction dans laquelle les organismes impliqués tirent tous les deux un bénéfice de leur association. Transposée aux humains, cette relation n’est viable que si le bénéfice du plus puissant est garanti par le labeur du plus faible. En cas de défaillance, l’association est tout naturellement rompue. Mais le processus ne s’arrête pas pour le plus puissant : il recommence, mais avec un nouvel « alibi ethnique », un autre « informateur indigène ».
7/Vous terminez votre livre sur un message poignant de vérité en écrivant « Je pense que ni Kamel Daoud, ni moi ne serions en train de débattre de la sorte si l’Algérie n’avait pas payé un lourd tribut afin de mettre fin au joug colonial français et accéder à son indépendance ! Dans le meilleur des cas, nous serions, lui à Mesra (village près de Mostaganem) et moi à Fillaoucène (village proche de Tlemcen), en train de garder les cochons et les truies du colon du coin, plongés dans une misère affreuse et une ignorance multigénérationnelle, sauf peut-être l’aptitude à reconnaître les gorets des verrats ». Cette négation du passé colonial et d’une partie de l’identité de l’écrivain est-elle le passage obligé de toute stratégie de reconnaissance par l’Occident ?
En effet, ceux que je désigne sous le vocable d’écrivains « néocolonisés » font tout pour se départir du passé colonial et, de ce fait, d’une partie de leur identité comme expliqué précédemment.
Par exemple, entre les deux voyages du président Macron en Algérie (février et décembre 2017), Kamel Daoud a fait plusieurs déclarations dans ce sens : « l’exploitation de la colonisation de l'Algérie doit cesser », « l'exploitation du fonds de commerce de la guerre d'Algérie doit cesser » ou « le postcolonial m'étouffe ».
Le jour de la deuxième visite du président français, Boualem Sansal a déclaré à un journal français : « L'Algérie, c'est la France, et la France, c'est l'Algérie ! ».
Effacées les 132 années de colonisation, d’exactions, de crimes, de tortures, de viols, d’expropriations et de misère ! Demander une repentance de la France ? Quelle hérésie ! Exiger que la colonisation française soit officiellement déclarée « crime contre l’humanité » ? Quelle ignominie !
Et qu’a dit le président Macron en décembre dernier à Alger ? « Il faut tourner la page ».
Et pourquoi aurait-il dit autre chose puisque les « alibis ethniques », les « informateurs indigènes » ont préparé le terrain du tourne-page ?

« Zabor ou les psaumes » : de « la préface du nègre(1) » à sa « lactification hallucinatoire(2) »
Par Djawad Rostom Touati

Le dernier roman de Kamel Daoud, pour lequel le chroniqueur aurait «renoncé au journalisme», afin de s’y consacrer, aura été la montagne de mots qui recouvre la souris. On eût pu s’attendre à quelque changement de registre, à quelque idée neuve, ou seulement à une nouvelle approche, un angle plus nuancé pour ânonner ses mantras habituels. La volonté y est palpable, mais le résultat peu probant.
Pour servir la thèse centrale de son livre, et qu’il avait rabâchée maintes fois dans ses chroniques, Daoud pousse jusqu’à l’extrême son postulat, accusant l'excès afin de faire passer le point de controverse comme norme : s'il y a lutte autour de l'imposition (ou plutôt du maintien, depuis l'époque coloniale) de la langue française comme langue du pain et du savoir, Daoud surenchérit en faisant de celle-ci la langue de la démiurgie. A la croyance en la langue arabe comme langue de l'au-delà (du paradis) et de l'en-deçà (des tablettes préexistantes au monde), Daoud oppose un contre-mythe : la langue française créatrice de vie, ancrée dans le réel, dimension qui lui manquait pour parachever son hégémonie : «J’écrivais dans une langue étrangère qui guérissait les agonisants et qui préservait le prestige des anciens colons. Les médecins l’utilisaient pour leurs ordonnances, mais aussi les hommes du pouvoir, les nouveaux maîtres du pays et les films immortels. Pouvait-elle être sacrée comme si elle descendait du ciel ?»
On voit d’emblée toute l'importance de l'informateur local dans cette «littérature» mercenaire : il fallait rien de moins qu’un individu versé dans l'orthodoxie religieuse, et l’ayant longuement pratiquée, pour accomplir ce travail de «renversement», là où, dans «L'Arabe et le vaste pays de O(3)», ce travail se confinait à la profanation, au persiflage et à la caricature. Cette tartine étant passé relativement inaperçue, Daoud reprend son travail de sape des croyances musulmanes, mais en les retournant, osant cette surenchère grâce à l'auréole du succès de «Meursault : contre-enquête». Bien que Daoud, dans «La préface du nègre», eût cassé de l'indigène avec le zèle névrotique de celui qui veut dépouiller un moi qui lui brûle désormais la peau, telle une tunique de Nessus, son recueil de nouvelles, rebaptisé «Minotaure 504» outre-mer, et auréolé d'un vague prix littéraire, n'avait pas eu le retentissement de Meursault. Ce dernier aurait sans doute connu le même fiasco sans la chronique, en plein bombardement de gaza, qui l'a lancé : c'est toujours, comme l'a si bien souligné le professeur Abdellali Merdaci, dans les marges de leurs «œuvres» que les mercenaires rédigent les réclames tonitruantes de leurs navets.
Nous voilà donc avec un démiurge qui est l’unique esprit éclairé dans un village perdu : on retrouve le fantasme de «Djibril au kérosène», moins la rancune du génie ignoré des siens. Dans «Zabor», le génie n'est pas ignoré mais «incompris» et un peu craint, perçu comme une curiosité. Il est le point de mire des villageois, mais reste une incongruité : on voit tout le chemin parcouru depuis «Djibril au kérosène». Là où il pleurait sur l'absence des projecteurs, dans «Zabor», le personnage se pose comme élément allogène parmi les siens, car trop en avance sur eux : «Dans une ou deux générations, on allait sûrement saisir le sens de ma trahison et me pourchasser. Ou m’aduler.» Et ce grâce au miracle de la lecture et de l'écriture, qu'il est le seul à pratiquer : on retrouve le mantra des indigènes imperméables à la culture et aux livres.
Pourquoi ce parallèle ? C’est que, comme dans «L’Arabe et le vaste pays de O» (qui avait donné son titre au recueil récipiendaire du prix Mohamed Dib, avant que Barzakh n’optât pour «la préface du nègre» comme titre de publication), Daoud, obsédé par l’image de l’Occidental se rendant maître de la nature, là où l’Arabe ne saurait que la saccager et en faire un désert, avait développé cette thèse en faisant parler un Vendredi arabe. Prétexte pour railler l’islam (y mêlant la caricature de textes authentiques et d’autres apocryphes), et essentialiser «l’Arabe», en accumulant un tombereau d’images d’Epinal sur fond de désert, de babouches et de tapis de prière. Considérant qu’il a accédé à une essence supérieure après l’immolation de l’indigène qui demeurait en lui, dans «Zabor», il s’agit de prendre de la hauteur : «Car, à certaines heures inspirées, je m’imaginais sous la forme du perroquet Poll, auteur d’un somptueux vacarme sous les tropiques, oiseau au destin exceptionnel et civilisateur dans une île inconnue. J’avais pêché ce nom dans un livre écrit au XVIIIe siècle qui raconte un naufrage, la rencontre avec un présumé cannibale et l’histoire de la solitude.» Livre dont il dira d’ailleurs : «J’ai aimé cette histoire il y a longtemps et, depuis, il a pris pour moi la valeur d’un livre sacré.» Cela se comprend aux exégèses bouffonnes qu’il tente d’en faire. A certain passage, Zabor y va franchement : «Moi, Robinson arabe d’une île sans langue, maître du perroquet et des mots.» Encore une consécration et ce sera carrément dans la peau d’un Robinson tout à fait «lactifié» que Daoud nous dispensera ses pompeuses leçons… A moins que la nécessité de conserver une couleur «locale» ne le confine à des limites territoriales purement formelles.
Mais je m’égare, comme il arrive souvent à Zabor le long du livre, de son propre aveu. Voici donc l’histoire d’un démiurge sans qui les siens n’auraient point d’existence : «Si j’oubliais une personne, elle mourait le lendemain. Aussi simple.» Le mythe de Prométhée récrit à l’intérieur des représentations islamiques : si Prométhée vole le feu aux dieux pour le donner aux hommes, Zabor transforme ses cahiers en tablettes préservées pour y écrire la vie de ses congénères. D’emblée, la citation des premiers versets de la sourate du calame aiguillonnent vers cette voie. Zabor professe un peu plus loin : «L’écriture est la première rébellion, le vrai feu volé et voilé dans l’encre pour empêcher qu’on se brûle.» Et c’est lui, le Prométhée de village, qui rend ce fier service aux incultes et analphabètes qui l’entourent : «De tous les miens, je suis le seul à avoir entrevu la possibilité du salut en écrivant. Le seul à avoir trouvé le moyen de supporter l’absolue futilité des lieux et de l’histoire locale, le seul restaurateur possible, le commissaire de notre exposition sous les yeux de Dieu ou du soleil. Tous mes cousins, cousines, parents et voisins tournent en rond sans le savoir, s’abîment en prenant de l’âge et finissent par se marier jeunes et par se goinfrer jusqu’à la maladie. La seule consolation à leur sort est la somnolence, ou le paradis après la mort qu’ils peuplent de leurs rêves en répétant les versets qui le décrivent verdoyant et licencieux. Je suis le seul à avoir découvert une brèche dans le mur de nos croyances. J’en suis fier, il faut le dire, vigilant quant à la vanité qui me menace, confiant face aux vents.» On se demande ce que cela eût été sans cette vigilance.
Le rapport de Zabor aux siens, de la « compassion » (sic), progresse assez rapidement vers la condescendance, puis le franc mépris : comme s’il prenait de l’assurance, ou comme si, la bride sur le cou, il ne pouvait plus retenir ce mépris latent de surgir à la surface, Zabor y va de ses sentences sur la fratrie jalouse et cupide, le père borné et avide, la tribu consanguine et inculte, le village anachronique et perdu, etc. Les clichés favoris d’Amine Zaoui servent de décor à la rage narcissique de Daoud. Le fin du fin… Zabor prétend donner une substance éthérée à ce mépris, par une posture de hauteur ataraxique vis-à-vis des siens, et qui rappelle la distance – voire l’indifférence – du personnage de «Meursault contre-enquête» vis-à-vis de l’indépendance : «À cause des milliers d’histoires qui tournent dans ma tête, j’ai pris mes distances avec les grandes émotions. Je vis comme décentré, à l’extérieur du village, dans son cœur noir.» Cette distance ne l’empêche pourtant pas de jubiler quand «ceux-là mêmes qui se moquaient de mes talents dans les cafés ou à la sortie de la mosquée finissaient un jour ou l’autre par me solliciter, tête basse. La mort rend bête et soumis, je le sais de métier, et avant de venir me trouver, mes détracteurs se rendaient à la peur comme du bétail. Pourquoi moi, et pas les récitateurs du Livre sacré ou l’imam ? Peut-être parce que je possédais le bon alphabet, neuf et ravivé par mon dictionnaire sauvage ? […] Je comprenais que ces gens-là puissent hésiter longtemps avant de venir frapper à la porte de notre maison du bas, alors que les récitateurs étaient nombreux et que la médecine était gratuite dans notre pays.»
La biographie de Zabor se déroule au fil des pages, en une longue et indigeste parodie des récits coraniques, qu’il prétend faire «descendre» à la trivialité de la vie terrestre, pour y magnifier son existence : avatar abâtardi du double mouvement de Hegel ? Son père s’appelle Brahim, boucher ayant embrassé cette vocation «sur un rêve de Dieu». Zabor a douze frères qui le haïssent et le jalousent à cause de son «don pour interpréter les rêves dans les livres». Il est abandonné par son père avec sa tante Hadjer. Son frère aîné l’avait précipité dans un puits quand ils étaient gosses, etc. Il serait fastidieux de relever tous les détournements (qui n’ont rien à voir avec le concept développé par les situationnistes) qu’opère Daoud avec un rare mauvais goût, tant on y décèle l’âcre ressentiment de l’informateur local envers la foi de ses origines. Et le récit n’en finit pas, remontant à l’enfance du narrateur, depuis laquelle sa singularité s’affirmait déjà : plus intelligent que les autres gosses, l’esprit plus vif, ceux-ci le jalousent d’être le fils d’un riche boucher. Sujet à des crises de panique, on fait quitter à Zabor l’école publique avant de le faire entrer à la médersa pour y étudier le Coran. Alors qu’il est près d’apprendre la totalité du Livre sacré, il en a un jour par-dessus la tête, et quitte l’école coranique. Un beau jour il découvre une mallette remplie de livres en français, et ce sera «une trouée d’air(4)» dans l’asphyxiant climat de son village perdu. Apprenant tout seul comme un grand à déchiffrer ces livres, ce sera le coup de foudre pour cette langue sur laquelle il fait pleuvoir les épithètes les plus flatteuses.
Le long du récit, de manière disparate, Daoud tente une réflexion sur le rapport du signifié au signifiant, mais à peine entame-t-il sa glose qu’il se débine en remâchant tel souvenir ou en se rabattant sur telle description. Tâchant de bâtir sa réflexion sur un concept mal maîtrisé, le récit s’étire, comme pour diluer – ou faire oublier – la redondance de ces tentatives avortées de donner à cette vulgaire catharsis une dimension conceptuelle. D’autant que cette «réflexion» ne sert en définitive qu’à rabâcher ce qu’il a maintes fois énoncé : la langue arabe est impropre à décrire le présent, le vécu, elle n’est bonne qu’aux textes et discours religieux, et à ressasser une histoire magnifiée et «idéologisée, politisée». Au rebours de la langue française, «langue de la mort pour ceux qui se souvenaient de la colonisation, mais pas morte». D’où la mission de Zabor, qui aime à se prendre pour le perroquet de Robinson: «Peut-être que le village où je vivais n’était qu’une île renfermée et sourde que j’étais chargé de libérer par de longs récits et l’apprentissage d’une langue plus vaste, plus vigoureuse, plus proche de celle du naufragé que de ses perroquets qui tournaient en rond, obligés d’inventer une grammaire, des religions, des livres, des plats et des fruits, des prénoms et des passions avec seulement cinq mots et un prénom mystérieux et déserté? […] J’étais l’oiseau qui perpétue une phrase, la reproduit jusqu’à l’avènement du langage riche.» Ladite phrase, on l’aura compris, est : «Pauvre Robinson, où es-tu?»
Incroyable aveu, parmi d’autres encore. «Par exemple, j’éprouvais de la compassion pour autrui tant que ce dernier était une abstraction, une absence inscrite dans le souvenir. Mais, confronté au corps et à la douleur d’une personne présente, je refroidissais dans l’indifférence, m’éloignais dans l’exercice de l’écriture.» Cela explique sans doute les rêves de puissance et de souveraineté que prétend nourrir Daoud, sans doute in abstracto là aussi, pour l’Algérie.
Ou bien, sur son incapacité à sortir du pastiche : «J’ai en effet toujours l’impression secrète que je vole le texte de quelqu’un d’autre et cela me rassure, car la paternité et la prise de parole m’angoissent terriblement.»
On retrouve aussi, le long de ces pages, le grand fantasme du sauveur : d’abord celui du village, qu’il s’agit de «sauver de sa futilité». Mais surtout des femmes recluses aux «corps encerclés», confisqués : Zabor s’entiche d’une femme répudiée et enfermée depuis sa répudiation, «décapitée» ; et il est le seul rayon de soleil dans l’existence de sa tante vieille fille.
Pastiche de Defoe, pastiche de Camus, pastiche du Coran : à ce jour, nonobstant le nauséabond «O pharaon», et peut-être «La fable du nain», que je n’ai pas encore lu, l’œuvre de Daoud, chroniques comprises, n’est que pastiches. Ce qui eût pu être intéressant si l’intention parodique ne s’inscrivait pas dans un opportunisme vis-à-vis d’un agenda néocolonial auquel ses nervis ont de plus en plus de mal à faire diversion, ne trouvant comme réfutation que le persiflage éculé sur l’argument de «la main étrangère».
Car, bien sûr, impossible pour Daoud de parler d’un village algérien sans évoquer sa décadence par rapport à sa splendeur supposée durant l’époque coloniale. Comme son idole, incapable de voir «l’Arabe» réifié, la révolution de son sort après l’indépendance lui échappe totalement. Seul lui importe le contraste entre les maisons prises aux colons et celles construites par les indigènes, inachevées et faisant tâche dans le décor. Toutefois, les références au temps bénit de la colonisation, «avant que le pays ne soit libre et inutile» (La préface du nègre), en comparaison avec la supposée déliquescence de l’indépendance, sont plus subtiles que dans ses précédents ouvrages : «A l’époque, il y avait la misère, mais pas l’injustice.» (Meursault contre-enquête.) «Comme tous les autres villages, il perdit sa liberté avec l’Indépendance et le départ du Colon, cet homme blanc qui le traitait comme un âne mais le pensait quand même vivant.» (L’Arabe et le vaste pays de O.) Ayant opéré sa mue, ayant enfin été coopté par les milieux germanopratins, Daoud, pacifié, y va moins fort dans ses comparaisons, d’autant que la conjoncture politique des rapports entre l’Algérie et la France lui imposent ce «nouveau cosmétique», pour reprendre l’expression du professeur Mohamed Bouhamidi. Il ne s’agit plus de magnifier le passé colonial, mais d’en faire table rase : la directive de Macron, aujourd’hui parfaitement explicite, va sans doute se traduire de manière plus claire dans les futures tartines de notre «écrivain», témoin sa dernière chronique en date, condensé, chez Daoud, des thèses qu’il dilue ensuite dans le verbiage de ses «romans».
Cependant, pour paraphraser Freud, chassez le refoulé, il reviendra au galop. Ressassant son mantra favori de l’indigène piégé par la lecture d’un Livre unique, «le seul livre qui accompagne l’Arabe de sa naissance jusqu’à sa mort» (l’Arabe et le vaste pays de O), Daoud en détourne les récits et références avec, là aussi, plus de subtilité que dans l’ouvrage cité – ou plutôt : de manière moins grotesque. Il recycle encore une fois l’opposition entre le français, langue «créatrice» et vivante, et l’arabe, langue «piégée par le sacré». L’ironie étant qu’il ne puisse le faire qu’à l’intérieur de ces représentations qu’il prétend ainsi liquider. C’est que, comme dans toute névrose obsessionnelle, il ne peut guère, malgré la forme relativement adoucie, s’empêcher de poursuivre son règlement de comptes avec cette part de lui-même dont il cherche fébrilement à se défaire, dans une compulsion de répétition qui prêterait à rire si elle ne s’accompagnait pas d’une projection de ce moi tant abhorré sur les indigènes, perçus comme un magma informe afin de mieux l’incarner. Faisant en partie sien, pour bien lui régler son sort, le principe que l’homme est un produit social, il s’agit pour Daoud de vilipender sans cesse les indigènes coupables d’avoir superposé, à son essence supérieure, leur obscurantisme et leur arriération, dont il aurait accidentellement et momentanément embrassé les dogmes, en échouant parmi eux par un malheureux hasard: «Et, ahuri volontaire, je distinguais, sur la grosse colline au nord, la coque éventrée de la maison de mon père, échouée là sur les récifs, dernière empreinte de mon naufrage.» Il lui faut donc constamment affirmer cette «accidentalité», en employant sa connaissance de ces dogmes et références à mieux les piétiner, avec ceux qui y adhèrent, depuis les hauteurs de son essence retrouvée.
N’apportant, une fois de plus, rien de nouveau sous le soleil algérien (et s’en justifiant sans doute en affirmant que rien de nouveau ne s’y passe), Daoud continue de ressasser, par le biais d’indigentes figures de style, les reformulations des mêmes thèses dominantes. Toutefois, fait amusant, en marge de ce travail mercenaire prédomine le besoin incoercible de revivre un fantasme sans cesse remis en scène, et qui fait que celui-ci finit par primer le travail de commande. Le chroniqueur ayant fait la courte échelle à l’écrivain, celui-ci se venge en marchant sur la tête du premier, pour hisser plus haut son idée fixe : je ne suis pas des vôtres, mais je reste parmi vous pour vous sauver de vous-mêmes et «de votre futilité», quand bien même vous dédaigneriez mon œuvre salvatrice.
Cela vous rappelle-t-il vaguement quelque chose ?
Références :
(1) Recueil de nouvelles de Kamel Daoud, publié en France sous le titre de «Minotaure 504».
(2) Expression employée par Frantz Fanon dans «Peau noire, masques blancs».
(3) Dernière des quatre nouvelles composant le recueil «La préface du nègre».
(4) «Le Noir, prisonnier dans son île, perdu dans une atmosphère sans le moindre débouché, ressent comme une trouée d'air cet appel de l'Europe.» Frantz Fanon, ibid.
De Cologne à Sétif : les approximations dangereuses d’une plume impatiente
Par Karim Kia

Statue de Ain el Fouara (Sétif, Algérie)
Dans cette Algérie de la fin 2017, les faits divers se suivent et ne se ressemblent pas, surtout à l’approche d’une année 2018 qui s’annonce difficile pour les algériens : loi de finances punitive, situation politique instable et sans issue, consacrant l’illégitimité du système en place. Et avec ce qui nous attend, il faut bien amuser la galerie !
Mais revenons à la chronique de KD écrite dans l’urgence (2) : pourquoi ne pas attendre les résultats de l’enquête ? Pourquoi faire une telle économie de détails, pour un intellectuel censé prendre de la hauteur par rapport au buzz et nous aider à mieux appréhender la complexité des évènements ? Pourquoi ne pas essayer, tout simplement, de savoir ce qui s'est réellement passé à Sétif ? Comble de l’ironie, quelques heures plus tard, les autorités révèlent, dans une déclaration officielle, que l’auteur de l’acte de vandalisme est un ancien militaire mentalement déficient (3).
Extrait de la chronique : « Nous n’aurons ni l’armée pour défendre ce pays contre sa talibanisation, ni la police mobilisée pour frapper sur le vivant algérien, les Kabyles et les démocrates, et qui supplie avec douceur et presque à genoux un destructeur au burin de nos richesses. Que faire pour ce pays et pour le défendre ? Prendre encore une fois les armes ? Se constituer en milices pour défendre cette terre puisque ce Régime ne le fait pas, ne le veut pas ? Ces islamistes ont bien compris : il faut des armes, des réseaux, des lieux de rassemblements, des médias et des vigilances sur tout, au bas de chaque statut, livres, lieux et cultures, déclarations. Nous devons faire de même... »
Ainsi, pour la plume impatiente de KD, peu importe les détails et les faits. Ce ne sera pas là sa première approximation depuis la fameuse « nuit de Cologne » et le scandale suscité par sa chronique dans le NY Times : déjà, en se basant sur de fausses informations, KD avait rendu sa sentence avant les preuves, avant l’enquête, déclarant que les viols et les agressions sexuelles commis pendant la Saint Sylvestre l’avaient été, sans aucun doute possible selon lui, par des réfugiés. Comment le savait-il ? Élémentaire, il était arrivé à la conclusion qu’ils étaient coupables en raison de leur rapport maladif à la femme, parce que musulmans tout simplement, rejoignant ainsi un cliché orientaliste bien installé dans l’inconscient occidental et heureusement, vite dénoncé par un groupe d’universitaire à travers une pétition lancée juste après son article (4 et 5).
Un tel fait divers est l’occasion, pour ceux qui ont l’habitude d’expliquer tous nos problèmes, non pas à l’aune de toutes les dimensions historique, politique et sociale de l’Algérie, ce qui serait précisément faire acte de « pensée », mais prétendent que ces évènements sont intrinsèquement liés à notre « culture » si lointaine de celle des Lumières et de la « modernité occidentale ».
Encore une forme d’essentialisation de l’arabe, du musulman, qui relègue ainsi l’impérialisme occidental au rang de dernière des explications de ce que nous vivons, relativisant tant les faits actuels que la longue histoire d’oppression de l’Autre que nous sommes, au point de réduire ceux qui y font allusion à des adeptes de la « victimisation »; cela pourrait être un sujet de débat, tant que cela est dit et analysé sur des tribunes qui n’auraient pas un background malsain. Le dire sur des tribunes occidentales bien connues par leur islamophobie et leur racisme, prend tout son pesant symbolique, et met en danger toute une population musulmane déjà fragilisée en Europe ; est-ce un hasard d’avoir en France le soutiens de Valls(6), Finkielkraut ou BHL ?
Toute idée prend sa signification depuis l’endroit à partir duquel elle est exprimée, surtout si elle n’est pas mise en perspective ni débattue sérieusement.
Mais cette dernière chronique sent fort, et pas du tout de l'eau de Cologne même pas de mauvaise qualité, chronique basée sur une information approximative et écrite dans l'urgence, toujours l'urgence d'étaler son humeur de révolté en colère. Traitant tous ceux qui ne sont pas de son avis de talibans ou de lâches, KD vient de franchir une ligne : celle de la violence. Un appel à la violence à peine « voilé » qui renvoie à une douloureuse page de l’histoire de l’Algérie indépendante, la « littérature de l’urgence » incarnée par Rachid Boudjedra (grand « ami » de KD (7)) et son brûlot « le Fils de la haine ».
On se souvient que Rachid Boudjedra avait donné, dans un élan romantique, un chèque en blanc aux militaires janviéristes suite à l’arrêt du processus électoral en 1992. Ces derniers, réjouis, n’en demandaient pas tant de la part d’intellectuels qui devraient avant tout tenir leur rôle d’analyse, de compréhension de leur société. L’islamisme n’a pas bouffé la société du jour au lendemain, il est né tel un bébé issu d’un viol, a tété le sein de la hogra et du mépris du peuple, du mépris de sa culture et de son identité ; il a appris à marcher à l’ombre de ses grands frères en Egypte, en Arabie Saoudite et en Afghanistan soutenus par les intérêts d’un capitalisme sauvage et de services secrets bien connus, et s’est exprimé dans la violence la plus inouïe face à l’incompréhension de nos élites totalement déconnectées du réel, de la réalité de l’Algérie profonde et de la grande majorité des algériens.
A la fin des années 80 et début des années 90, les intellectuels algériens étaient encore figés à traiter de la chute du mur de Berlin, alors qu’il y avait péril en la demeure. Pour changer du système totalitaire algérien, une partie du peuple, la moins instruite, la moins à l’aise matériellement avaient adopté puérilement (ce qualificatif ne les dédouane en rien) la radicalité la plus évidente qui se présentait à elle, face à des gauches qui avaient perdu la vigueur de leur idées, la fraicheur de leur idéaux, et ne présentaient plus d’alternative viable à leur peuple à qui ils ne savaient plus parler. Aucun crime n’est excusable, absolument aucun. Reste que l’on n’attend pas de nos intellectuels qu’ils se mettent à dos de chars pour ramener la démocratie. L’usage de la force, c’est l’armée et la police. L’intellectuel doit transcender sa société, l’interroger, la comprendre et la faire avancer, non pas cracher dessus ni sur une partie d’elle.
25 ans après, le constat reste le même. A coup d’approximations, de précipitation, de simplification de la réflexion, de délire hystérique, de colère et de faiblesse d’esprit, les échecs d’hier risquent de se reproduire aujourd’hui, une faillite qui risque d’alimenter l’hystérie générale dans la société, et enfoncer le pays dans une spirale violente encore une fois.
En quoi KD est foncièrement différent de ceux qu'il dit combattre ? Pour quelqu’un qui a été islamiste dans une autre vie, j’aurais aimé qu’il mette à disposition son expérience, qu’il apporte de la hauteur et de la complexité dans ses écrits et qu’il analyse le phénomène de l’intérieur, en somme, se mettre au-dessus de la mêlée. Sans vouloir faire dans la psychologie de comptoir, il y a chez lui comme un transfert en attribuant aux autres ce qu’il est lui, in fine : un converti au laïcisme, avec en sus les réflexes extrémistes de l’islamisme. Car il présente en tous les symptômes. L’approximation jusqu'à la désinformation ? On y est. La fatwa laïque ? C'est un peu ce qui est décrété dans ses tribunes à longueur d'année. L'appel à la violence ? C'est chose faite à présent ! Nous sommes très nombreux à nous sentir otage de ce schéma que les intellectuels approximatifs, d’une part, et les radicaux islamistes, d’autre part, nous imposent. Ils sont tellement semblables ! Incapacité à relever la complexité des sujets, pensée simple et unidirectionnelle, faiblesse de l’argumentaire et de l’esprit, et une colère, une très grande colère !
Entre Hamadache (8) et KD je n'ai pas envie de choisir.
Cette vision binaire du monde fragilise et sape tous ceux qui, dans le silence, résistent au rouleau compresseur qui nous broient au quotidien imposé par le système politique algérien en place. Tous ceux qui essaient de jeter des ponts entre des courants de pensées, apaiser les esprits, cohabiter avec leurs différences, travailler, créer, innover, construire, et espérer aller vers une société qui rassemble les algériens. Un tel projet est ardu. Et c’est parce que c’est difficile et complexe, que cela vaut la peine de le faire et de travailler pour une adhésion de tous les algériens. Les discours culturalistes d’exclusion qui font plaisir à l’occident ne rendront la tâche que plus difficile, créeront de la crispation, du rejet et de la tension.
A voir se déployer une telle carrière, un ami m’a dit, à propos de KD : « nous avons perdu un grand chroniqueur, la France a gagné un piètre écrivain. ».
Références :
- Vidéo de la destruction de la statue, https://www.youtube.com/watch?v=J8_WSvqwPuE
- Kamel Daoud, la destruction de la statue de Ain el Fouara. http://www.chouf-chouf.com/chroniques/kamel-daoud-la-destruction-de-la-statue-de-ain-el-fouara/
- Article sur l’état mental auteur de l’acte de vandalisme, https://www.tsa-algerie.com/ain-el-fouara-lauteur-de-lacte-de-vandalisme-presente-une-deficience-mentale-a-100-video
- Kamel Daoud, La Misère Sexuelle Du Monde Arabe : https://www.nytimes.com/2016/02/14/opinion/sunday/la-misere-sexuelle-du-monde-arabe.html
- Nuit de Cologne : « Kamel Daoud recycle les clichés orientalistes les plus éculés », Le Monde.fr, http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/02/11/les-fantasmes-de-kamel-daoud_4863096_3232.html
- Valls soutient KD : https://www.facebook.com/notes/manuel-valls/soutenons-kamel-daoud-/1002589256488085/
- Boudjedra VS KD : http://www.algerie-focus.com/2017/10/polemique-kamel-daoud-reponds-a-tour-a-boudjedra-decide-de-porter-plainte/
- KD vs Hamadache, http://www.jeuneafrique.com/308178/societe/algerie-kamel-daoud-gagne-proces-contre-predicateur-salafiste-abd
Kamel Daoud ou les métamorphoses du même au même
Par Mohamed Bouhamidi

L’appel de Kamel Daoud à constituer des milices (1) restera le seul fait politiquement et moralement significatif de l’épisode de la tentative de destruction de la statue de Ain el Fouara à Sétif. L’auteur était un ancien militaire, malade mental. Il fallait un imaginaire foisonnant pour détecter derrière le marteau du fou un complot à la fois immense, multiforme et ramifié et aussitôt en appeler à sauver le pays.
Il a fallu juste quelques heures pour que « La dépêche de Kabylie » et le quotidien « L’Expression » confirment que le forcené est effectivement un malade mental, ancien militaire, sous traitement psychiatrique et totalement irresponsable.
Kamel Daoud a réagi comme si l’événement était un stimulus, un signal à la Pavlov et non comme un fait. Je préfère la formule de notre Baaziz national : «Où tu jettes l’appât, il plonge ». Il a fait, illico, le procès de tout ce qui peut bouger ou murmurer en dehors de son propre camp et il le désigne nommément : « Nous n’aurons ni l’armée pour défendre ce pays contre sa talibanisation, ni la police mobilisée pour frapper sur le vivant algérien, les Kabyles et les démocrates, et qui supplie avec douceur et presque à genoux un destructeur au burin de nos richesses. » Son camp c’est le vivant algérien et seulement les Kabyles et les démocrates. Cela fait beaucoup de monde, en face, à éradiquer de toute urgence à la lecture de leurs qualificatifs dont celui, répugnant, de rats. BHL, l’ami de Kamel Daoud, pourrait disserter sur le sens des bestiaires convoqués pour parler des humains.
Karim Kia s’en étonne dans sa chronique : « De Cologne à Sétif, les approximations dangereuses d’une plume impatiente ». Chronique sagace qui s’interroge plus sur la pertinence de la lecture du fan-club de Kamel Daoud que sur la problématique lucidité du chroniqueur-écrivain.
Pourtant, Cologne aurait dû inciter Kamel Daoud à mesurer ses réactions et attendre le minimum d’enquête et de vérification avant de se lancer dans des condamnations sans recours de cultures, d’ethnies, de sociétés et de l’Islam, pour tout fait dissonant d’avec les bonnes règles du politiquement correct français. La justice allemande a, depuis cette fameuse nuit, infirmé la réalité des viols tels que présentés et innocenté ces migrants maghrébins ou généralement arabes ou musulmans accusés d’être par nature des violeurs.
C’est la deuxième envolée où Daoud en appelle, cette fois-ci pour l’acte d’un malade mental psychiatrisé, à la création de milices, synonymes de guerre civile, de sang, de massacres, de viol, de zones de non droit, de destructions de tous genres, de douleurs indicibles. Le mot milice est surtout synonyme d’effondrement du sur-moi individuel et collectif sous l’injonction d’un idéal supérieur, qui devrait nous élever à hauteur d’indigènes aimables aux yeux de l’Occident. La contradiction n’est que de façade avec l’idéal d’un Etat théocratique qu’il devait nous imposer quand il était chef d’un groupe salafiste. La métamorphose du salafiste en démocrate n’est que celle du même qui voulait détruire notre Etat national au nom des pères de la pureté islamique au même qui veut détruire notre Etat national au nom de la loi des pères occidentaux qu’il se cherche. "
Le Dr. Farid Chaoui a réagi à cet appel si lourd de périls, appelant à la raison de Kamel Daoud en soulignant la conséquence la plus catastrophique de ses injonctions, comme on le fait avec un enfant pas trop conscient de ses actes : « Nous serions donc trois races d’algériens : Les « rats barbus », les « idéologues de la soumission » et « les autres, les bons » qui ne s’entendraient que sur une seule vérité : la guerre, l’extermination totale, la purification ? » (2)
La purification, on en connaît le sens d’Hitler à Daech. C’est bien ce à quoi appelle Daoud et que vous pouvez lire en suivant ce lien (3).
Sur Cologne, il nous avait avertis (4). Dans une émission où on l’interroge sur les réactions à son papier concernant Cologne, il balaye les critiques émises à son essentialisme en confirmant que son texte n’est pas à lire sur le factuel mais comme message. Il signalait que l’Europe dans sa générosité, à offrir des camps et de la soupe, aux migrants de la zone arabe ou musulmane ne ferait pas d’eux des gens fréquentables ou des voisins civilisés. Elle importait sur ses territoires des êtres imprégnés d’une culture de la violence, de l’enfermement des femmes, du viol, de l’absence de contrôle de soi etc. Il planait au-dessus du factuel pour inciter l’Europe à voir plus loin que son nez.
C’est pour cela que Cologne ne pouvait l’instruire sur la façon de réagir à Sétif.
Daoud plane dans les grands scénarios historiques, pas dans la misérable besogne de la vérification des faits et de leurs connexions grâce à ce que nous apprennent les sciences sociales, à savoir que nos faits et nos productions mentales sont malgré toutes leurs apparences de spontanéité reliées à des causes proches ou lointaines.
Le prophète parle au nom de la vérité qu’il porte et non au nom de la réalité.
Aucun argument ressortissant de cet examen du réel ne peut répondre à un fantasme. L’ordre de la réponse c’est le fantasme.
Pourquoi diriez-vous au fan club de Kamel Daoud que les arabes peuvent être chrétiens et pas musulmans, ou musulmans mais druzes croyant à la métempsychose, ou musulmans et alaouites aux mœurs très libres, ou zyadites et rigoristes, ou donc qu’être arabe ne signifie en rien être musulman ?
Pourquoi signaler que des musulmans peuvent être de pays, de cultures, de civilisations et de mœurs complétement dissemblables et que la musulmane de Damas ou Alep a si peu à voir avec celle d’Afghanistan et que même au Pakistan tellement musulman, une dame a été premier ministre ? L’impossibilité du débat avec cette littérature de la bonne vieille agit-prop (agitation-propagande) de Kamel Daoud est que nous sommes face à des représentations qui nous renvoient à un réel non pas social et politique mais celui de ses fantasmes.
A quoi bon rétorquer à son fan-club que contrairement à ce qu’il dit les femmes algériennes ne sont pas enfermées dans un espace clos. Elles forment la majorité des enseignants tous paliers confondus et ce n’est pas rien d’être prof de fac de lettres ou de médecine ; qu’elles forment la majorité du corps médical, la majorité du corps des magistrats ; que si deux voitures passent dans nos villes, la troisième est conduite par une femme. Elles prennent place dans les terrasses de café au centre-ville d’Alger, ailleurs je ne sais pas, et elles entrent dans tous les cafés, fast-foods, restaurants d’Alger et sont accueillies normalement. Ces spectacles de femmes occupant l’espace public et professionnel s’offrent à nous tous les jours.
Force nous est faite de constater que son obsession ne renvoie à aucune réalité indiscutable d’une Algérie vide de ses femmes. Ni même à la réalité concrète des femmes encore soumises à la règle patriarcale du gynécée. Elle reste comme obsession juste le symptôme d’un problème individuel et en rien un indicateur social. Cette idée de bousculer l’image du père, voire de le changer, en tous cas d’en signaler la pesante présence, suggère fortement un recours à Freud mais ce n’est pas l’affaire de ce propos.
Sur la question des migrants et de leur culture supposée unique et misogyne comme sur celle des femmes, Kamel Daoud confirme qu’il ne s‘adresse pas aux européens concernant les motivations économiques et politiques des dirigeants, mais sur l’effet de leurs décisions quant à l’avenir de la civilisation européenne. Il n’est vraiment pas le premier à délivrer ce genre d’alerte à la menace de la barbarie que représentent sûrement les dizaines de milliers de médecins, de cadres, d’enseignants, de techniciens, d’entrepreneurs et de commerçants invisibles qui constituent le gros de notre émigration aujourd’hui. C’est le pain quotidien de Zemmour, Finkielkraut, Houellebecq, Fourest ou le F.N. Boualem Sansal a également alerté sur cette erreur civilisationnelle de l’Europe. Kamel Daoud dit quelque chose de plus : ces migrants viennent avec la loi de leurs pères. Et c’est précisément là le lieu de l’impossibilité de l’intégration, un père doit disparaître pour que la loi devienne unique. Les migrants ne peuvent devenir européens qu’en renonçant aux lois de leurs pères. Les migrants en sont donc réduits à être en besoin de tuteur et d’adoption. La dualité, ici, transparente, est que le migrant ne peut renoncer au père originel qu’en devenant le fils du nouveau père, la personne en accord avec la nouvelle loi. Et il ne s’agit pas des lois générales de l’Etat ou de la logique ou de la pensée, mais de la loi du père, de nos père puisque Kamel Daoud la mesure obsessionnellement à la condition de la femme, enfermée, cachée, prisonnière et à laquelle on ne peut accéder qu’en en passant par l’allégorie freudienne du Totem.
Les discours de Sansal et de Daoud sur l’erreur de la « bonté » européenne ne sont similaires qu’en surface. Alors que Sansal assume tranquillement son passage à l’autre rive, par son voyage en Israël, ainsi que le port de la kippa, Daoud en reste à une agressivité sans retenue vers son semblable haï, l’arabe et le musulman. Il tape comme un sourd sur tout ce qui peut rappeler une origine. Sa critique du soutien « tribal, ethnique ou religieux » aux Palestiniens en est l’expression la plus pathétique et la marque la plus indiscutable du caractère fantasmatique de ses écrits. Les soutiens aux Palestiniens viennent du monde entier, des pays les plus divers, des cultures les plus dissemblables, de l’ensemble des couleurs de peaux humaines, des écrivains, des artistes et des cinéastes les plus affirmés, des universités occidentales les plus prestigieuses. Bref le soutien à la Palestine est le moins religieux, le moins ethnique et le moins politiquement monolithique depuis le boycott de l’apartheid. L’empathie pour les souffrances de ce peuple est devenue le vecteur de la résistance à l’impérialisme, voire du retour de l’idée que les peuples sont semblablement humains par leurs parts diverses de langue, de culture, de croyances. Il s’oppose à la solidarité avec le peuple palestinien pour les raisons qu’il dit abhorrer, parce qu’il est perçu musulman et arabe, pour des raisons ethniques et religieuses. Il lui est tellement insupportable de voir que ses origines sont un fait d’histoire et non un affect coincé ? Il est vrai que se placer dans une histoire nous oblige à voir les connexions de notre vécu avec l’environnement historique lui-même et admettre que nous sommes, comme humains, au moins en partie, un produit de notre histoire. Toute l’adresse aux européens sur leur naïve bonté tomberait à l’eau.
Tout algérien, socialement impliqué, qui aurait la mémoire de la présence coloniale ou celle des années d’après l’indépendance, pourrait nous rappeler que cette haine des origines ne relève pas du seul affect individuel. Cette violence symbolique assénée à notre peuple était aussi celle des castes féodales supplétives du colonialisme français après avoir été supplétives des Ottomans. Double discours de disqualification, d’une part, des tribus turbulentes et anarchiques ou des classes serves à tenir en main, et d’autre part offre de service à l’occupant. « Les arabes ne comprennent que la trique et ne sont pas amendables » que nous avons entendu de nos congénères indique bien que le complexe du colonisé n’est pas seulement une pathologie de l’indigène aliéné mais loge aussi dans les intérêts de castes intéressées à une domination étrangère. Agonir les arabes et les musulmans en général, et les soutiens arabes et musulmans des palestiniens au passage, se prolonge aussi dans un destin social, dans la recherche d’un statut social. Ici, la validation se fait par l’Autre, par le colon, par sa reconnaissance que le candidat supplétif est apte à relayer la parole, la vision et les ambitions de l’Autre. Et pour l’instant, aucun candidat ne le surpasse dans l’art du sophisme.
Le texte remarquable de Djawad Rostom Touati décrypte la démarche fantasmatique du retour du héros qu’espère incarner Kamel Daoud, revanche de celui qui devient, lui, le père, la source des nouvelles lois. L’appel à la formation des milices n’est pas un texte surgi d’un néant psychique. Il est présent depuis très longtemps, dans la violence symbolique dont il nous agonit depuis sa première chronique. Il a toujours écrit non pour comprendre mais pour combattre.
En 2005, paraît son roman qu’il appellera récit pour le rendre plus « vrai » : « Ô Pharaon » (5). Il parle d’une ville de l’ouest algérien, Relizane, qu’il ne nomme pas, lieu des méfaits des patriotes et Groupe de Légitime Défense qui ont mené la lutte anti-terroriste et qu’il désigne sous le vocable de milices. Il en fait les responsables d’un inventaire hallucinant de crimes, de vols, de viols, de concussions, d’assassinats, au milieu d’un assentiment passif de la population, qu’il décrit née de la prostitution diffuse, de mœurs dépravées et perverses. Une engeance qui ne méritait nul salut, pitié ou considération. Toute la haine de ces populations écrasées par l’histoire coloniale dit une haine de classe des castes féodales qui n’ont pas pardonné à ces gueux d’avoir occupé les terres et les biens coloniaux vacants, d’avoir remis en cause la suprématie naturelle des maîtres. C’est le tableau d’une population de bâtards dominée par une organisation criminelle commandée par un homosexuel. Dans la métonymie et le métalangage présents dans ce roman, le terme homosexuel ne renvoie pas à l’orientation sexuelle mais à la vieille perception dégradante de pédéraste, être dominé par la force ou par un vice. Il suggère le vice bien sûr, il ne fallait pas moins que le vice pour gouverner une ville de bâtards. Le lecteur en concevrait même de la sympathie pour les bandes du GIA que l’auteur ne désigne jamais comme terroristes.
Comment peut-on chanter les standards des pères européens et être homophobe à ce niveau d’eaux usées ? Parce que dans ce livre, Kamel Daoud ne s’interdit aucune arme, même pas celle-là. Pour s’attaquer aux patriotes, la fin justifie les moyens, l’éthique est un inutile embarras. Il était chargé de mission.
2005, c’est l’année de plus grande controverse sur la Concorde Civile et sur la réconciliation, et il y avait besoin urgent de produire des textes renvoyant dos à dos patriotes et terroristes.
Ce livre est une charge sans règle contre les patriotes, une véritable écriture milicienne, celle de la guerre idéologique totale contre un courant politique et social qui a sauvé notre pays. Un appel au feu et au meurtre. C’est une écriture au service d’une thèse, non d’une quête de la compréhension d’une Algérie qui change, qui bouge, comme dans les œuvres de Mouloud Mammeri ou de Mohamed Dib, d’une Algérie qui cherche ses pères et sa femme magique.
Au service d’une thèse, elle est en sus une écriture mercenaire, une écriture à la commande, comme ce Meursault, le premier livre dans l’histoire de la littérature à avoir une version pour indigène et une version pour la métropole. (6)
Toute la difficulté de penser l’écriture de Daoud tient dans la difficulté à déchiffrer les fantasmes et leurs liens avec l’inconscient individuel. Ceux de Daoud, scénarios individuels, se logent dans les scénarios des projections du changement des régimes, du changement des lois, et du meurtre de nos pères. C’est cette location qui a fait la notoriété de Daoud pour les services qu’ils pouvaient rendre aux nouvelles ambitions coloniales. Quel intellectuel français, même raciste, peut se permettre de tenir de tels propos sur les musulmans sans en payer le prix lourd de rémanence raciste ?
La France médiatique s’est soulevée contre les treize chercheurs en sciences sociales qui ont alerté que les propos de Daoud sur Cologne sont ceux d’un vieux discours raciste et essentialiste et en rien une nouveauté. Cette France des médias a paniqué qu’il existe encore une prétention à l’exercice public des sciences sociales qui finiraient peut-être par dévoiler leurs propres jeux L’alliance des médias et de Daoud est l’alliance la plus réactionnaire jamais vue en ce 21ème siècle, celle qui devra effacer deux siècles d’avancées en sciences sociales pour rendre impossible l’intelligence des liens entre les productions mentales et les enjeux en cours dans notre réalité sociale. . Les découvertes de Freud, de Marx, de Bourdieu, de Lacan, des ethnologues et d’autres disciplines liées à la sociologie la psychologie ou l’économie doivent mourir pour que se déploient sans risque les narratives de l’impérialisme.
Non, son appel à la création de milices dont il sait si bien quelles sont les métaphores des pires souffrances ne sont pas un accident ou une précipitation mais bien le désir de passage à l’acte de sa constante violence symbolique qu’il nous assène du haut de ses fantasmes puérils qui ont trouvé si bien à se loger dans le complexe du colonisé et dans la haine de soi si vivaces par les carences de nos politiques culturelles d’une part et dans le théâtre d’ombre des ambitions néocoloniales d’autres part.
Références :
1- http://www.chouf-chouf.com/chroniques/kamel-daoud-la-destruction-de-la-statue-de-ain-el-fouara/
2- http://librealgerie.info/2017/12/25/reponse-dun-inquiet-a-un-desespere/
3- L’Expression, http://www.lexpressiondz.com/article/0/0-0-0/282252.html
4- La Dépêche de Kabylie, http://www.depechedekabylie.com/evenement/184146-un-fou-sest-attaque-a-la-statue-dain-el-fouara.html
Lire le dossier complet sur Calaméo