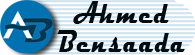ARABESQUE AMÉRICAINE D’AHMED BENSAADA
Les printemps déchus du Net arabe
Par Abdellali Merdaci
 En écrivant Arabesque américaine. Le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe (Alger, Synergie, 2012 [Préface d’Abrous Outoudert] ; 1ère éd., Montréal, Les Éditions Michel Brûlé, 2011), un utile essai sur l’implication de la première puissance mondiale dans les récentes transformations, il est vrai fort abruptes, de pays arabes, jusqu’alors sanglés dans des dictatures bédouines, appréciées et soutenues par l’Occident, Ahmed Bensaada n’en exclut pas les difficultés et les répercussions. Mais devait-il pour autant convaincre son lecteur de la distance qu’il marque aux faits, en se recommandant davantage de la posture du chercheur que du militant ? L’auteur d’« Arabesque américaine » apparaît, tout au long de l’ouvrage, comme un analyste scrupuleux, soucieux de rechercher et de fixer, à travers une exceptionnelle documentation, les conditions d’une lisibilité d’évènements encore tout proches.
En écrivant Arabesque américaine. Le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe (Alger, Synergie, 2012 [Préface d’Abrous Outoudert] ; 1ère éd., Montréal, Les Éditions Michel Brûlé, 2011), un utile essai sur l’implication de la première puissance mondiale dans les récentes transformations, il est vrai fort abruptes, de pays arabes, jusqu’alors sanglés dans des dictatures bédouines, appréciées et soutenues par l’Occident, Ahmed Bensaada n’en exclut pas les difficultés et les répercussions. Mais devait-il pour autant convaincre son lecteur de la distance qu’il marque aux faits, en se recommandant davantage de la posture du chercheur que du militant ? L’auteur d’« Arabesque américaine » apparaît, tout au long de l’ouvrage, comme un analyste scrupuleux, soucieux de rechercher et de fixer, à travers une exceptionnelle documentation, les conditions d’une lisibilité d’évènements encore tout proches.
Une fondation américaine de la démocratie dans le monde arabe
L’ouvrage s’organise en six chapitres d’une portée didactique (« Les révolutions colorées » ; « Ces organismes américains qui « exportent » la démocratie » ; « Les nouvelles technologies » ; « Le cas de l’Égypte » ; « Les autres pays arabes » ; « Quelques éléments d’analyse »), débusquant les soubassements des ruptures dans des champs politiques arabes, réputés figés et indémontables, comme ceux de la Tunisie de Zine El ’Abidine Ben Ali et de l’Égypte de Hosni Moubarak. L’hypothèse que met en œuvre et défend Bensaada est d’infirmer la spontanéité du soulèvement de la « rue arabe », de Tunis au Caire. Pourra-t-il estimer que le temps du « changement » a été assurément réfléchi et maturé dans de nombreuses officines américaines ? Plus exactement une quinzaine d’organismes (Cf. leur liste, pp. 115-117), aux objets sociaux les plus divers, sont recensés, dispensant conseils et financements dans le monde, au nom d’une sacro-sainte démocratie. Pour la première fois dans l’Histoire, des « révolutions » sont dévolues aux possibilités des technologies de l’information. Feront-elles date ? D’emblée, l’auteur oppose un salutaire doute devant des révolutions « facebookiennes », très vite récupérées par des structures et des acteurs politiques du passé. « Est-cela une ‘‘révolution’’ ? », s’interroge-t-il, insistant sur le caractère illusoire d’une histoire arabe qui ne cesse de se défaire : « Est-il pensable que l’immense éléphant n’ait accouché que d’une minuscule souris ? »
Bensaada explique ce phénomène du « retour au sérieux », à Tunis et au Caire, endiguant les promesses romantiques de Sidi Bouzid et de la place Tahrir, en recadrant des enjeux internationaux et des positionnements de leardership. Comme dans les « révolutions colorées » de l’ancien bloc soviétique, les États-Unis d’Amérique sont encore une fois à la manœuvre. Curieusement, cette présence américaine n’est pas toujours le fait d’institutions de l’État, mais d’organismes privés, comme L’USAID (United States Agency for International Development), la NED (National Endowment for Democracy), Freedom House, Open Society Institute, créé par le financier George Soros. L’analyste évoque ainsi le « marché de la démocratie » et la surface d’action de ses fournisseurs. À titre d’exemple, l’USAID déclare avoir investi plus de neuf milliards de dollars, lors des deux dernières décennies, pour « promouvoir la gouvernance démocratique dans plus de cent pays ». Ce type d’assistance ne peut s’exercer que dans le champ politique, directement auprès d’acteurs et d’institutions gouvernementales ou de personnalités ou groupements politiques de l’opposition légale ou clandestine – ou encore d’acteurs sociaux sans attaches politiques définies. Il requiert nettement l’usage de l’information de masse. Comme dans les « révolutions colorées » (Ukraine, Géorgie), Internet a été un puissant facteur d’alertes sociales et politiques dans le monde arabe ; il sera énergiquement présent en Tunisie et en Égypte, faisant émerger à travers les blogueurs de nouveaux profils d’agents sociopolitiques.
Bensaada n’en méconnaît pas l’efficacité et la détermination, qui observe : « Les nouvelles technologies constituent, sans aucun doute, l’outil idéal pour tout révolutionnaire désirant déstabiliser un régime. Elles permettent tout d’abord de transmettre et d’échanger des informations à une très grande vitesse, en plus de faciliter la mobilisation d’un grand nombre de personnes autour d’un projet commun ». En Tunisie, selon le NDItech, un organisme de surveillance, le hashtag « #sidibouzid » a été tweeté « 28000 fois par heure » pendant les journées chavirées de la révolte. La cyber-dissidence – de Tunisie et d’Égypte, certainement la plus visible – aura à écrire en lettre de sang les épisodes les plus ténus d’un monde qui change et qui se pare des effluves du printemps, plus précisément du « printemps arabe », qui célèbrera assez vite ses héros de la toile : Waël Ghoneim (Égypte) et sa compatriote Israa Abdel-Fattah, mieux connue comme « la Facebook girl », Ali Abdulemam (Bahreïn), Tal El-Mallouhi (Syrie), Hisham Elmiraat (Maroc) et l’emblématique Slim Amamou (Tunisie), promu au rang de secrétaire d’État à la jeunesse et aux sports dans le gouvernement intérimaire de Mohamed Ghannouchi, formé au lendemain de la chute ubuesque de Ben Ali. Héros sans origine, mutants de la planète numérique, les blogueurs arabes défient les sérails nationaux pour faire prévaloir de nouvelles logiques et de nouveaux discours, qui ne doivent plus rien aux politiques conventionnelles.
Ce monde touffu de la cyber-dissidence bénéficiera des découvertes les plus pointues de spécialistes américains, toujours à la parade pour proposer des solutions de secours, lorsqu’il s’agira, au plus fort des démêlés de la place Tahrir, fin janvier-début février 2011, de contourner la censure du Net par les autorités égyptiennes. Une agence d’ingénierie informatique américaine TOR ne mettra-t-elle pas au point un logiciel favorisant la navigation anonyme sur Internet ? TOR rendra de signalés services en Iran et ailleurs dans les territoires enclos de la cyber-dissidence mondiale, saluée par des membres du gouvernement américain, notamment Mme Clinton. Bensaada relève combien le financement des activités de TOR situe un maillage de milieux divers, comme Google, Human Rights Watch et la Marine de guerre américaine. Mais cet engagement du gouvernement des États-Unis n’évite pas le paradoxe : un des animateurs de TOR n’est autre que Jacob Appelbaum, un des fondateurs de WikiLeaks, à l’origine de la révélation de milliers de câbles secrets de sa diplomatie.
Ahmed Bensaada consacre son quatrième chapitre (pp. 49-76) au cas symptomatique de l’Égypte. Il fait une description soigneuse, fourmillant d’indications précises, d’une phase postmoderne de l’histoire de ce pays où interviennent des acteurs et des technologies hautement sophistiqués. On y lit le cheminement (précoce ?) du soulèvement populaire de la place Tahrir, saisi à travers le portrait de l’activiste Bassem Samir, directeur de l’Egyptian Democratic Academy, spécialement instruit aux techniques de la communication et de l’agitation sociale aux États-Unis, mais aussi en Hongrie et à Dubaï. Il n’y a, en effet, rien de spontané dans la démarche de ce dissident, comme de bien d’autres, aux ambitions affûtées par les différents services américains. Et l’auteur rappelle in fine que la toute première reconnaissance donnée aux manifestants de la place Tahrir a été celle du sénateur républicain John McCain, fondateur de l’IRI (International republican institute).
Les États-Unis, indique Bensaada, conduisent un contrôle suffisamment rigoureux de toutes potentialités qui se manifestent sur l’Internet en n’importe quel lieu du globe. Le « réseautage » des cyber-dissidents dans le monde est une des missions de l’organisme privé AYM (Alliance of Youth Movements). On apprend ainsi dans « Arabesque américaine » que les cyber-dissidents arabes se connaissaient et avaient eu l’occasion de concertations avant et pendant les événements qui ont embrasé leur pays, notamment autour du blogueur Slim Amamou. Le journaliste français Pierre Boisselet n’hésitera pas à mettre en scène une « Ligue arabe du Net ». Et chacun est assuré, avec le recul dont on dispose aujourd’hui, que ces « révolutions » avortées resteront longtemps le seul marqueur de ces printemps désormais déchus du Net arabe.
L’Algérie aussi
« Arabesque américaine » n’a pas ignoré le très spécifique épisode algérien. L’Algérie était-elle un objectif des « révolutions » arabes et un terrain propice aux nombreuses organisations américaines de propagation de la démocratie dans le monde ? Bensaada convoque de furtives images d’une organisation éphémère, la CNCD (Coordination nationale pour le changement et la démocratie) qui associa au moment de sa création la LADDH (Ligue algérienne de défense des droits de l’homme), le SNAPAP (Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique) et le RCD (Rassemblement pour la Culture et la Démocratie) du docteur Sadi, avec le projet de nourrir la « contestation du gouvernement ». Jusqu’à quel point était-il possible d’incriminer les États-Unis dans ce printemps algérien déçu ? L’auteur se contente de faits et de supputations : aussi bien la LADDH que le SNAPAP entretenaient des rapports avec des organismes américains. Si la LADDH apparaissait dans les bilans de financement de la NED, en 2002, 2004 et 2005, le SNAPAP serait proche du Solidarity Center, une officine de la NED. Il est certes mentionné le câble diplomatique américain, diffusé par WikiLeaks, rapportant une discussion entre Saïd Sadi et l’ambassadeur des États-Unis, à Alger ; la presse de l’époque n’avait-elle pas glosé l’image d’un chef de parti souhaitant un « soutien extérieur pour la survie de la démocratie » en Algérie ? Enfin, de récentes données chiffrées de 2009 de la NED, annexées au texte et non commentées, décomptent le versement de 251215 dollars à trois associations civiles algériennes (Center for International Private Enterprise [CIPE], Collectif des familles de disparu(e)s en Algérie [CFDA], National Association of the Families of the Disappeared).
À l’évidence, le bilan algérien de cette entreprise américaine de fondation de la démocratie dans le monde arabe apparaît bien mince et les acteurs ciblés – institutions publiques connues et reconnues – déparent des figures toute neuves des « révolutions » arabes. À Alger, il n’y avait pas les équivalents de Slim Amamou ou de Waël Ghoneim. Et le Net, en de rares et pittoresques tentatives, a si peu compté. Cette singularité – proprement algérienne – ne devrait-elle pas être discutée ?
Est-il nécessaire de rappeler ici que l’essai « Arabesque américaine » a été écrit dans une première étape des mutations des champs politiques arabes, alors même que la situation était encore pendante en Libye, au Yémen – et qu’elle l’est encore tragiquement en Syrie ? Le lecteur accueillera certainement avec intérêt le travail honnête d’Ahmed Bensaada, qui livre une œuvre d’analyse sociopolitique originale, écrite dans une belle langue fluide, qui mérite d’être lue par les spécialistes ; elle apportera au grand public des éclairages judicieux et surtout une somme d’informations inédites en Algérie.
A.M.
Cet article a été publié dans les colonnes de "Reporters", le 1er décembre 2012
Cliquez ci-dessous pour lire la version "journal"